LA GÉOGRAPHIE ET LA DÉCOUVERTE DU PACIFIQUE
Présentation
F Marguet conclu :
- C’est ainsi que les astronomes, les artistes et les navigateurs dessinaient les contours du monde. Le problème de la longitude à la mer était né avec les premiers grands voyages de découvertes. Il s’achevait avec ceux de la fin du XVIIIe siècle et du commencement du XIXe. Ceux-ci furent la conséquence naturelle et presque nécessaire des très longs travaux à la suite desquels on avait trouvé des solutions pratiques à la redoutable question. Sa signification complète ressort de ce rapprochement, et il éclaire, en les réunissant dans un même ensemble, quelles que soient leurs différences, les deux grands élans qui portèrent les hommes, à trois siècles d’intervalle, à parcourir les océans, pour connaître le globe auquel ils sont attachés et en étudier les ressources. Il est le lien qui unit Colomb, Gama et Magellan d’une part, Cook, Lapérouse et Dumont d’Urville d’autre part.
![]()
Partie très largement oubliée de notre patrimoine historique, les découvertes de grands marins français permirent et la mise au point des moyens de pilotage et surtout l’émergence d’une cartographie indigente il y a encore si peu de temps. Voir en particulier trois articles publiés par ailleurs sur PTP sur Marion Dufresne :
- Marion Dufresne, les hasards malheureux de l’histoire
- La navigation de Marion Dufresne
- Le Marion-Dufresne II et les navires océanographiques
Pour lire ce dossier, dans sa version initiale (mise en page de 1931), télécharger le PDF de ce chapitre à ce lien
Le fac-similé dans la version de 1931, dans sa totalité, est ici
Une longitude exacte, à bord d’un bâtiment, ne peut servir qu’à la condition de pouvoir être rapportée à des régions du globe exactement repérées, autrement dit il était « inutile d’avoir la longitude du vaisseau à l5 ou 20’ près, comme l’écrivait Chabert, si les cartes n’avaient pas la même exactitude ». De plus une carte bien faite peut servir à tout le monde, tandis qu’une longitude sans erreur à bord d’un navire ne peut renseigner que lui seul. Ainsi il était encore plus urgent pour la sécurité de la navigation de lever et de tracer de bonnes cartes que de pouvoir bien naviguer individuellement. C’est ce besoin de faire avancer la géographie qui faisait dire à Chabert, dès 1753, avec un sens juste de l’identité des moyens à employer pour obtenir la longitude à la mer et à terre, lorsqu’il s’agit de la reconnaissance hydrographique rapide des côtes, qu’on devait s’attendre à voir bientôt la géographie perfectionnée par les observations de la Lune. Trente ans plus tard, il ajoutait que les montres étaient « aussi utiles pour la géographie que pour la navigation ». Sans elles, en effet, on aurait toujours été « forcé de se contenter d’un très petit nombre de déterminations », tandis qu’elles « fournissaient des moyens prompts et surs de multiplier les observations de longitude à terre ainsi qu’à la mer ». C’est ainsi que pendant la guerre d’Amérique, il avait déterminé la longitude du cap Henlopen, dans la Delaware, en transportant avec ses chronomètres, pendant 13 jours, les résultats d’une éclipse de Soleil calculée plus tard avec les observations correspondantes d’Europe. Il l’avait trouvée de 77° 33’, différente de 0’,5 seulement de la longitude obtenue par le passage de Vénus de 1769 et de 8’,5 du nombre donné par les éclipses des satellites de Jupiter de 1767 à 1769. La valeur véritable est d’ailleurs 77° 33.
![]()
Fleurieu était du même sentiment ; « les horloges permettent de rectifier les cartes qui sont très imparfaites », dit-il, et, dans le voyage de l’lsis, il s’occupe systématiquement de ces rectifications qui l’absorbent au moins autant que les montres elles-mêmes. Dans la relation du voyage il donne les préceptes à observer pour effectuer convenablement le tracé des cartes sur papier. En particulier il indique, d’après une théorie de Bouguer, la valeur des cotes de l’échelle des latitudes en tenant compte de l’excentricité du méridien terrestre [1]. Mais c’est dans le récit de la campagne de la Flore qu’on trouve pour la première fois, clairement et complètement indiqués, les principes des « levers hydrographiques sous voiles », règles qui vont être suivies tout de suite après et pour longtemps. Elles sont faciles à résumer. On fixe les positions importantes en les relevant dans la direction est-ouest aussi près que possible d’une observation de latitude, dans la direction nord-sud au voisinage d’une détermination de la longitude, et les longitudes sont rapportées à des stations dont la position à été déterminée soit par des observations astronomiques faites à terre dans des observatoires élevés dans ce but, soit le plus souvent par un très grand nombre de distances lunaires. Ce sont alors les montres qui, réglées dans ces stations, servent à donner à chaque instant les différences de longitude entre ces lieux origines et ceux ou on observe des angles horaires, et d’autant mieux que les traversées pendant lesquelles on les utilise à cet effet sont plus courtes. « Les distances sont préférables aux chronomètres, disait La Coudraye en 1785, lorsqu’il s’agit d’observer à des distances de temps éloignées, tandis que les garde-temps sont au contraire préférables pour de petites distances. » Enfin, chaque fois qu’on le pourra, on contrôlera les montres par elles-mêmes en revenant en un lieu dans lequel on est déjà passé, de manière à obtenir la valeur de l’erreur commise entre les deux séjours au même point, et on embarquera deux montres au moins, les valeurs journalières de leur marche relative avertissant alors du dérangement de l’une d’elles. Les relèvements et segments capables enfin sont, bien entendu, largement utilisés. En 1776 Borda fit une campagne hydrographique par les méthodes indiquées ci-dessus. Il détermina alors sur la Boussole les positions géographiques principales des Canaries et des points de la côte d’Afrique comprise entre le cap Spartel et le cap Bojador. Il avait, au départ de Brest, l’horloge 18, à poids, de Ferdinand Berthoud, et sa montre à ressort n° 4, construite en 1773. En passant à Cadix, il embarqua aussi l’horloge à poids n° 10 acquise par l’Espagne, qui avait commandé huit montres à F. Berthoud, et il donna alors le n° 4 à Chastenet-Puységur, commandant l’Espiègle, qui prenait part à l’expédition. En cours de campagne, le 18 devint d’ailleurs inutilisable par suite de la rupture du ressort de suspension, mais les deux autres donnèrent toujours de bons résultats. Il déterminait l’état sur le temps local et la marche par l’observation de hauteurs correspondantes à terre. Et il écrivait à Berthoud : « Je crois avoir fait une très bonne carte de la côte d’Afrique, de Spartel à Bojador, et des Canaries ; mais certainement il m’aurait été impossible d’en faire une pareille sans vos horloges. J’ai eu l’occasion de reprendre les mêmes points à différentes reprises et j’ai trouvé un accord qui prouve que cette manière de faire les cartes est très précise. » Il donna à Sainte-Croix de Ténériffe une longitude de 18° 35’ 20« et on admet aujourd’hui 18’ 34’ 31 ». Il rechercha encore la hauteur du pic de Teyde et trouva cette foi la valeur exacte de 1.904 toises (3.713 mètres). C’est encore pendant cette campagne enfin qu’il imagine et emploie la méthode des relèvements astronomiques, par la distance angulaire d’un point terrestre au Soleil
![]()
La même année, Chabert faisait, avec deux montres de Berthoud, une nouvelle campagne dans la Méditerranée.
Chastenet-Puységur profita de l’expérience acquise pendant le voyage de la Flore, sur laquelle il était embarqué en qualité de garde-marine, et pendant sa campagne d’Afrique, faite en compagnie de Borda, pour dresser, en 1784 et 1785, un Pilote de Saint-Domingue. Il avait trois montres : la petite horloge n° 1 et le n° 28 de F. Berthoud et une montre A ; mais nous ne savons pas si c’était celle de Le Roy. Nouet, de l’ordre de Citeaux, l’accompagnait à titre d’astronome. Le 28 ne put servir qu’au début ; les deux autres, au contraire, furent surtout régulières après la première partie des opérations.
![]()
A partir de 1784 et pendant plusieurs années, Rosily, savant officier et ancien compagnon de Kerguelen et de Suffren, fit de même une campagne hydrographique destinée à rectifier le Neptune oriental de d’Après. Il embarqua sur deux navires, la Vénus et la Méduse, et travailla sur les côtes de Madagascar, d’Anjouan et du cap Guardafui, de la mer Rouge et du détroit de Bab-el-Mandeb, du golfe Persique et des bouches du Sind ; de Ceylan et de l’Inde orientale ; enfin de la Cochinchine. Il alla même jusqu’à Manille. On voit que ses explorations s’étendirent sur toute la côte sud de l’Asie. Il emportait les montres XXIII et XXIV de F. Berthoud. Cette dernière, terminée en 1782, était horizontale, à ressort et fusée, mais toujours à balancier suspendu et à châssis de compensation agissant sur le spiral. Elle avait un échappement à vibrations libres (Berthoud y était revenu définitivement), plus simple que celui de l’horloge n° 9 et l’aiguille battait la seconde.
![]()
Plus tard, ce même Rosily, devenu vice-amiral et directeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine, fit entreprendre un travail plus indispensable qui consistait dans la rectification des côtes occidentales de France et la détermination de positions en Méditerranée. La première partie fut effectuée sous la direction de Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe, assisté surtout d’hydrographes, mais aussi de quelques officiers de marine, lieutenants de vaisseau ou enseignes et d’élèves de la marine. Rossel était alors sous-directeur du Dépôt. On donna à Beautemps-Beaupré les goélettes la Recherche et l’Astrolabe, dont les campagnes s’étendirent sur dix années, de 1816 à 1826. Daussy fut chargé de la triangulation côtière entre Brest et la frontière espagnole. Il mesura tous les angles des stations principales au cercle répétiteur astronomique de Borda. C’était un cercle entier à deux lunettes, monté sur un pied, de façon à pouvoir être orienté d’une manière quelconque par rapport à la verticale. Cassini, rendant compte des opérations entreprises en 1787 pour la jonction de Paris et de Greenwich, qui fut faite avec le nouvel instrument, dit que « la pratique ayant confirmé la précision singulière que la théorie annonçait de la part du cercle entier dans la mesure des angles pris suivant la méthode de Borda avec le cercle de réflexion, ce savant s’occupa de l’application de cet instrument aux observations géodésiques pour la mesure des angles sur le terrain », ce qui montre la liaison de la recherche de la longitude et de la nouvelle triangulation. De plus, les angles à la mer étaient pris avec le cercle de réflexion.
![]()
En même temps Roussin, en 1816 et 1817, prolongea sur la Bayadère et le Lévrier, l’hydrographie de la côte d’Afrique depuis Bojador, ou s’était arrêté Borda, jusqu’aux iles de Loss, au sud du Rio Grande. Il employa la méthode de ce dernier en se servant de quatre montres de Louis Berthoud, dont il vérifia la perfection en revenant souvent aux mêmes points. L’ingénieur hydrographe Givry était de ces voyages qui furent suivis, après 1819, de la reconnaissance des côtes du Brésil par la Bayadère assistée du brick le Favori. La Bayadère avait alors les montres 56 et 99 de Louis Berthoud. Elles étaient suspendues à bord, dans une armoire où on entretenait, au moyen d’une lampe, une température uniforme de 30° centigrades. La marche de la montre 56, grâce à ce régime, ne varia que de 0’,45 en 55 jours. Enfin, en Méditerranée, des positions furent fixées de la même manière par le capitaine de frégate Gauttier, qui fit campagne sur la gabarre la Chevrette, de 1816 à 1818. Il employa sept montres. La marche du 80, par exemple, ne subit, de mars 1816 à septembre 1817, qu’une variation de 6s. Les autres furent aussi très bonnes et les résultats obtenus donnaient toute satisfaction, étant donnés les moyens employés. En effet, Gauttier fixa entre autres la longitude de la Galite à 2’ près ; celle du Stromboli à moins de 1’.
![]()
Dès que les montres eurent commencé à faire leurs preuves, on songea à les utiliser pour la découverte du continent austral qui, depuis longtemps, hantait les rêves des géographes européens. On croyait généralement à son existence, même dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Quelques-uns pensaient qu’il était nécessaire à l’équilibre du monde pour compenser la grande masse d’eau des océans du sud. Sur la carte d’Ortelius de 1587, la Terra australis s’appelle Terre de Feu, au sud de l’Amérique, dont elle n’est séparée que par le détroit de Magellan. Elle s’éloigne davantage de l’Afrique, puisqu’elle en reste à 13 ou 14°. C’est là qu’elle porte le nom curieux de « région des Perroquets » (perroquets de mer ou macareux, sans doute) que les Portugais lui avaient donné « ob incredibilem earum avium ibidem magnitudinem ». Enfin, sous l’Insulinde elle dépasse deux fois dans le nord le tropique du Capricorne et ses deux points extrêmes atteignent les latitudes de 15° sud au sud de Java et de 24° sous la Nouvelle-Guinée. On y avait même annexé cette île de Java : « quelques-uns se sont imaginé que c’est un continent qui confine au continent méridional qu’on nomme magellanique, Terre australe inconnue ou Terra del Fuego, Terre de Feu. » Au commencement du XVIIIe siècle, Frézier, doublant le cap Horn et y rencontrant des icebergs « îles glacées qui sont un mauvais voisinage parce qu’on y feraient naufrage comme contre de véritables îles, et plus tristement même, leur froideur étant mortelle et étant très escarpées », disait Radouay, y voit une preuve de l’existence de ce continent méridional : « s’il est vrai comme plusieurs le prétendent, dit-il, que les glaces ne se forment en mer que de l’eau douce qui coule des terres », il faut conclure qu’il y a des terres vers le pôle austral. Notons que plus d’un siècle auparavant on affirmait que « la pleine mer ne se glace point ».
![]()
Ils n’avaient pas tout à fait tort de croire à ce continent fabuleux, puisqu’il existe effectivement, quoique en proportions beaucoup plus réduites que celles que leur imagination lui assignait. Même leur idée d’équilibre du monde n’était pas si sotte, puisqu’on la retrouve dans les conceptions d’Elie de Beaumont et de Green, assujettissant la terre aux symétries géométriques d’un réseau pentagonal ou d’un tétraèdre, et aussi chez Faye et les partisans de l’isostatisme, preuve de la persistance des idées fondamentales en lesquelles se résume la science et qui servent de jalons aux recherches des savants.
![]()
Toujours est-il qu’en 1771, Kerguelen fut envoyé à la découverte de ces terres australes. Ses instructions portaient que le continent en question devait s’étendre jusqu’aux latitudes de 45°, et il lui était recommandé de « lier commerce et amitié avec les habitants » et « d’examiner les manufactures du pays », s’il y en avait. Kerguelen partit de Lorient le 1er mai 1771, emmenant Rochon qui tentait encore une fois des aventures maritimes. Celui-ci était arrivé à bord avec la montre n° 6 de F. Berthoud. Il n’avait pas de table de la variation de la marche avec la température, mais il trouva quand même que les observations démontrèrent « la marche régulière et uniforme de ce garde-temps ». Rochon observa des distances lunaires dans la traversé qui prit fin à l’Ile de France le 19 aout. Mais il ne continua pas au-delà de cette relâche, parce qu’il ne s’entendait pas avec Kerguelen. Celui-ci, en effet, n’avait aucune confiance dans les moyens employés pour observer la longitude, il s’obstinait à ne se fier qu’à l’estime et il n’eut même pas la sonde du Banc-des-Aiguilles. Rochon, qui se sentait inutile, était désespéré. Il tenta une dernière preuve de la valeur de sa méthode. Le 8 août, par 40° de latitude sud, ses observations indiquaient une erreur de 6° dans l’estime, et il avertit Kerguelen qu’ils allaient tomber sous le vent de l’Ile de France, lui affirmant qu’il ne pouvait se tromper de plus de 1° par les distances lunaires. Il parvint à obtenir de Kerguelen l’autorisation de faire atteindre cette île au bâtiment à l’aire de vent, sans reconnaître Rodrigue, ce à quoi il réussit en effet ; mais à l’arrivée il demanda quand même à débarquer. Kerguelen continua donc seul. Il refit d’abord la route de Grenier qu’il était chargé de vérifier et qu’il jugea préférable à celle qui était suivie jusque là. C’est ensuite que, dans une rapide campagne dans le sud, il aperçut l’île qui porte son nom et qu’il prit pour un continent. Après son retour, on ordonna une seconde campagne. Kerguelen partit des iles le 29 octobre 1773 avec le Roland et l’Oiseau. Il emmenait cette fois deux astronomes : Mersais, qui avait fait la Flore, et d’Agelet, ami et élève de Lalande. Charnières aussi était du voyage, mais Kerguelen déclarait avec quelque mépris « que ce n’était qu’un astronome » et qu’on ne pouvait compter sur lui comme officier, ce qui est un peu surprenant.
![]()
On lui avait confié les montres 8 et 11 de F. Berthoud. Les résultats obtenus furent à peu près nuls. Berthoud aurait voulu changer l’échappement du n° 11 qui était l’échappement libre du n° 9 ; de plus, la lame composée en était défectueuse, de sorte que sa compensation était très médiocre. Les tables de corrections pour la température ne se montrèrent pas en rapport avec les variations réelles ; elles donnaient des variations en sens inverse des véritables, comme si Berthoud s’était trompé de signe en les dressant. Il y eut des écarts diurnes de 12, 26, 29 secondes, dit Le Roy. Quant à l’horloge n° 8, Berthoud n’avait pas eu le temps de la remettre en état après la Flore. Enfin, Kerguelen conservait ses préventions. D’Agelet, d’après Lalande, voulait observer assidûment des longitudes, mais il était désolé de ne pouvoir rapporter toutes les observations astronomiques et géographiques qu’il désirait parce qu’ « on lui en ôtait le temps et les moyens ».
![]()
Donc les astronomes et les marins traçaient peu à peu, avec une exactitude de plus en plus satisfaisante, des cartes de l’Atlantique, de la Méditerranée et de la Mer des Indes. Mais il restait à figurer les immenses contours continentaux et insulaires de l’Océan Pacifique, très mal connu à la fin du XVIIIe siècle. L’Amérique du Sud, le sud de la Chine et l’archipel de la Sonde étaient à peu près fixés quoique grossièrement ; mais les côtes asiatiques et canadiennes qui s’étendent des deux cotés du détroit de Behring et les parties sud et est de l’Australie restaient des mystères. Les premières régions étaient en effet les points du globe les plus éloignés par mer des ports d’Europe, et les secondes restaient très en dehors des routes d’Europe aux Indes orientales, qu’on suivît l’itinéraire du cap Horn ou celui du cap de Bonne-Espérance.
![]()
En 1752, l’académicien Delisle avait fait construire, par Buache, une carte de la partie nord du Pacifique, qui montre bien la profonde ignorance dans laquelle on était, à cette époque, de la géographie de ces parages. Pour la région américaine, les documents principaux de Delisle consistaient dans la relation d’un prétendu voyage effectué en 1640 par l’amiral espagnol Fuente, envoyé à la recherche du passage fabuleux (dernier reste du fleuve Océan qui, pour les Grecs, enveloppait le monde) qui devait mettre en communication par le nord les deux principaux océans du monde. On n’a jamais connu de cette expédition qu’une soi-disant traduction anglaise du rapport de l’amiral, parue pour la première fois en 1708. Peut-être l’auteur anglais de ce document voulait-il simplement attirer l’attention de ses compatriotes sur la nécessité d’explorer, avant les Espagnols, les régions dont il parlait. Toujours est-il que la carte de Buache est absolument fantaisiste. On y trouve, par exemple, recouvrant les territoires de la Colombie britannique et de l’Alberta, « une mer de l’Ouest » trois fois plus étendue que la baie d’Hudson ; et c’est là précisément que se trouvent les monts Brown et Hooker, qui comptent parmi les plus hauts sommets des montagnes Rocheuses. On voit donc que Bellin, en 1764, était sagement inspiré en laissant en blanc la partie de ses cartes allant de Vancouver à Behring et en se contentant d’y écrire qu’il avait « trouvé la relation des prétendues découvertes de l’amiral Fuente trop suspecte et trop peu exacte pour l’employer » et qu’on « ignorait si, dans cette partie, c’était des terres ou de la mer ».
![]()
Quant à ses cartes de même date de la partie sud-ouest de la « Mer du Sud », on y voit la Tasmanie et la Nouvelle-Guinée réunies par des pointillés à la terre australienne, ce qui montre que Bellin ignorait les détroits de Bass et de Torres. Le Pacifique était cependant très parcouru ; le galion d’Acapulco le traversait régulièrement entre le Mexique et Manille ; et Dahlgreen a relevé plusieurs voyages autour du monde, accomplis par des marins français rien qu’au commencement du XVIIIe siècle. D’autre part, Lemaire et Shouten, en 1616, Roggevein, en 1722, Tasman, en 1742, en avaient parcouru le sud ; mais, lit-on dans une relation de 1785 du troisième voyage de Cook, « leurs découvertes avaient été très imparfaites ». Dans le nord, Behring et Tchirikof arrivèrent « peut-être » en 1741 sur les côtes canadiennes. Tout cela n’eut pour ainsi dire pas de résultats.
![]()
Pourquoi n’en fut-il pas de même des voyages multipliés qui commencèrent à Bougainville et à Cook ? On sait que les mobiles qui les firent entreprendre étaient très différents de la ferveur religieuse et du désir d’ouvrir des débouchés à des commerces précieux, qui furent les causes des grands voyages des XVe et XVIe siècles. « L’esprit d’aventure s’était affaibli, et on savait qu’il y avait peu à gagner pour le commerce dans ces découvertes », dit un éditeur de 1774 des voyages anglais accomplis entre 1760 et 1770. Ce fut la curiosité scientifique qui poussa en effet à ces nouvelles entreprises, car « c’est un défaut de curiosité bien coupable que de ne pas nous instruire de ce qui a rapport à notre planète », disait-on encore à l’époque. On voulait donc « ajouter aux connaissances qu’on avait sur la terre » et les compléter, « rectifier les positions », étudier les phénomènes des marées, les courants, le magnétisme, les sciences naturelles et l’humanité. Mais tout cela ne pouvait se faire que si la « rectification » et la détermination rapide des lieux était possible, d’où la liaison étroite qui existe entre la longitude et les nouveaux voyages. Ceux-ci furent le triomphe des nouvelles méthodes de navigation et leurs résultats en représentèrent les conquêtes. Quand on y regarde de près, on constate avec une pleine évidence (c’est ce qu’on pensait au moment des voyages de Cook) que « ces voyages de découvertes et les opérations du Bureau des Longitudes marchaient de concert et qu’il fallait les rapprocher si l’on voulait se former une juste idée de l’étendue du plan mis alors en exécution pour les progrès de l’astronomie et de la navigation », et vers 1800, Borda et Lévêque écrivaient de même que « les voyages dans la mer du sud portaient un grand intérêt » sur la longitude. Il y a effectivement entre la longitude et la découverte du Pacifique une liaison si intime qu’on peut affirmer que les voyages qui eurent lieu à la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe n’auraient été ni aussi nombreux, ni aussi retentissants, ni aussi fructueux si la navigation par l’estime avait continué à ce moment à être la seule possible. Peut-être n’auraient-ils pas eu lieu. C’est un fait qu’on n’a pas assez mis en relief à notre sens.
![]()
En 1765, Byron et Mouats, en 1767 Wallis et Carteret, traversèrent le Pacifique du cap Horn à Batavia ; mais ils firent ces voyages trop rapidement et avec des moyens trop insuffisants pour pouvoir « reconnaitre » le globe entre l’Amérique et le Cap, comme on le désirait. En 1769, Surville, de la Compagnie des Indes, sur le Saint-Jean-Baptiste, alla du Gange au Pérou en passant par les Baschi au nord des Philippines, les îles Salomon et la Nouvelle-Zélande ; et en 1771 Marion, avec le Mascarin et le de Castries, quitta le cap de Bonne-Espérance et toucha à la Nouvelle-Zélande où il fut massacré, après quoi ses bâtiments remontèrent à l’île de Guam et se rendirent à Manille. Mais leurs reconnaissances laissèrent également peu de souvenirs.
![]()
Le cas des îles Salomon par exemple est bien propre à montrer quelles incertitudes pesaient sur la navigation dans ces régions les plus éloignées d’Europe. Elles avaient été découvertes en 1567 par Alvarez de Mendana, parti du Callao. Mais pendant longtemps des doutes planèrent sur leur existence. Buache remarque que des géographes les ont bannies de leurs cartes. Situées à l’orient et près de la Nouvelle-Guinée, on les trouve cependant sur une carte de Théodore de Bry de 1596. Dalrymple les confond avec la Nouvelle-Bretagne et les place entre 2 et 6° de latitude au lieu de 5 à 12. Pingré les met par 190° de longitude est, Bellin par 185. Danville par 180, Delisle enfin par 170. Pingré les place ainsi à 700 lieues à l’est de leur vraie position, Bellin à 600, Danville à 500, Delisle à 300. Cette diversité, remarque Rochon, tenait « à l’impossibilité où on était de redresser les erreurs inévitables de l’estime ». En août 1767, Carteret rencontra plusieurs iles de l’archipel, qu’il cherchait : mais il ne se douta pas qu’il l’avait trouvé. En 1565 Byron avait abandonné cette recherche. Bougainville, Surville, Shortland y ont touché sans le moindre soupçon de les avoir rencontrées. On se souvient des plaintes de Colomb contre les pilotes incapables de reconnaitre des terres déjà découvertes.
![]()
Comme ils ignoraient à quel moment ils coupaient le 180° degré de longitude, les bâtiments ne corrigeaient pas alors leur date, par redoublement ou saut. Ils attendaient d’avoir retrouvé des Européens. « On ne savait point du tout ou l’on était, disent Lemaire et Shouten, après leur traversée du Pacifique vers l’ouest, ayant doublé le cap Horn ; si l’on était près ou non des îles des Indes, ni quels étaient les pays le long desquels on naviguait tous les jours, si c’était la nouvelle Guinée ou non » (c’était elle effectivement) ; ni « à quelle distance on se trouvait des côtes de Chili ». Et ils ne firent pas le saut de la date, pas plus qu’une flotte militaire hollandaise de onze vaisseaux vers le même temps. Ils n’ignoraient cependant pas la nécessité de la correction ; ni sans doute le cas des compagnons de Magellan qui, n’y ayant pas songé et retrouvant les Portugais de l’île Saint-Jacques du Cap Vert s’aperçurent alors seulement qu’ils étaient de un jour en retard et furent consternés d’avoir fait gras le vendredi et célébré Pâques un lundi.
![]()
Le premier voyage de Cook en 1769 et celui de Bougainville en 1766-69 eurent un éclat immense. On sait que Cook partit sur l’Endeavour, de 84 hommes et du port de 370 tonnes, pour observer le passage de Venus à Tahiti, et que le voyage de Bougainville fut considéré alors comme la première circumnavigation autour du monde d’un bâtiment français, ce qui n’est pas. Mais si ces expéditions méritèrent d’être placées hors rang, si elles ouvrirent réellement une aire nouvelle, cela tient surtout à ce qu’elles furent les premiers grands voyages maritimes pendant lesquels on observa systématiquement des longitudes à la mer [2] , fait qui fut considéré comme assez frappant pour qu’on ait désigné par un astérisque sur l’itinéraire de Cook, figuré sur la carte jointe à la relation de son voyage, tous les points ou la longitude a été observée. Des Falkland à Batavia il y en a vingt-cinq. C’est à ce titre que ces voyages nous appartiennent ici.
![]()
Bougainville partit de Brest le 6 décembre 1766. Il eut sous ses ordres la Boudeuse et l’Étoile. Le pilotin Véron, astronome de l’expédition, et l’enseigne du Bouchage étaient chargés des observations astronomiques. Le 25 novembre 1767, du Bouchage observa à l’octant huit distances luni-solaires et Véron cinq ; le 29, Véron en prit cinq autres et le 2 décembre ils purent relever le cap des Vierges. Ils fixèrent alors sa longitude à 71° 30’ par les observations du 27, à 72° 10’ par celles du 29 et ils adoptèrent pour sa position la moyenne de 71° 50’. On admet aujourd’hui 70° 42’. Cette première détermination de position géographique à la mer était donc relativement bonne. Véron avait aussi un mégamètre de Charnières. Continuellement il fit des longitudes par la Lune et apprécia les erreurs de l’estime. Avant l’arrivée à Tahiti, il trouva une différence de 2° 40’ entre les longitudes données par l’octant et par le mégamètre. Dans cette ile, la veille du départ, il employa la méthode de Pingré par l’angle horaire de la Lune conclu de sa hauteur. Les résultats extrêmes différaient de 6 à 7°. C’était beaucoup, mais cela confirmait simplement la critique de La Caille. Véron ne devait pas revoir la France. Il débarqua à l’Ile de France pour aller aux Moluques observer un passage de Mercure qui devait avoir lieu le 9 novembre 1769. Le Gentil le rencontra dans l’Inde au moment où il s’y rendait et c’est dans ces iles qu’il contracta, en observant la nuit, la fièvre dont il mourut le 1er juillet 1770, à son retour à l’Ile de France.
![]()
On connait l’expédition de Lapérouse qui, ayant quitté Brest dans l’été de 1785, décrivit dans le Pacifique un immense circuit dont une partie essentielle était formée par deux boucles s’appuyant sur les côtes nord-est et nord-ouest de cet océan. Dagelet, qui avait fait le deuxième voyage austral de Kerguelen, était à bord ; mais il était largement aidé par les marins. Ils emportaient un observatoire portatif, quatre cercles de Borda, trois sextants anglais, cinq horloges de F. Berthoud et un chronomètre anglais, et ils ne laissèrent jamais échapper l’occasion de faire des distances lunaires, qu’ils observaient au cercle, en multipliant les observations. Ils estimaient les tables lunaires approchées à 30" en moyenne, à 40 ou 50" au maximum et obtenaient la longitude à 15’ en général, et 30’ dans leurs plus grandes erreurs. A Tongatabou, dans les îles de l’Amitié, ils prirent un très grand nombre de distances et trouvèrent à 7’ près le même résultat que Cook qui en avait utilisé 10.000. Ils fixèrent par des distances les longitudes de Macao et de Cavite et leurs résultats s’accordent à 6’,5 pour la première, à 16’ pour la seconde avec les longitudes données actuellement.
![]()
Les petites montres à ressort 25, 27 et 29 ne rendirent pas beaucoup de services. En 1786, après dix mois de campagne, 25 et 29 ne méritaient plus leur confiance. Les horloges à poids 18 et 19 furent de beaucoup meilleures. Toutefois, à partir de juillet 1787, la marche du 18 fut si irrégulière qu’on ne savait quelle valeur lui attribuer. La 19, au contraire, resta toujours excellente. En 1786, après neuf mois, sa marche avait à 0s,5 près la même valeur qu’à Brest. Après dix mois, à partir de Conception (Chili), elle aurait donné à Macao une erreur à l’atterrissage de 2° 14’ seulement ; et avec la marche du 11 avril 1787 elle aurait donné le 5 septembre, après cinq mois, une erreur analogue égale à 1° 19’. De Macao à Cavite, en vingt jours, cette erreur était de 4’5. Enfin à Avatsha, six mois plus tard, sa marche n’avait varié que de 2 secondes sur celle de Cavite. aussi, après dix-huit mois de campagne, ils pouvaient encore écrire que les deux horloges étaient aussi satisfaisantes qu’au départ. Elles leur avaient servi à dresser une carte de cette partie de la côte canadienne que Bellin n’avait pu tracer vingt-deux ans auparavant et ils disaient que « la marche des horloges de M. Berthoud était si uniforme qu’on devait croire que cet artiste avait atteint le degré de perfection dont elles étaient susceptibles ». Mais les distances donnant les longitudes sans accumulation d’erreur leur servaient toujours de fondement. Ils comparaient les méthodes par la Lune et par les montres ; les différences allaient rarement à 25 on 30’.
![]()
Le 27 septembre 1791, Dentrecasteaux quitta Brest pour aller à la recherche de Lapérouse dont on n’avait plus de nouvelles depuis 1788. Il fit une fois et demie le tour de l’Australie en sens inverse des aiguilles d’une montre. On lui avait donné les deux frégates la Recherche et l’Espérance du port de 500 tonneaux et de 100 hommes d’équipages. Il emportait des cercles répétiteurs astronomiques et des cercles répétiteurs de Borda, les premiers étant destinés à observer des hauteurs à terre pour avoir des angles horaires, opération pour laquelle on mettait un niveau sur la lunette inférieure ; les horloges 17 et 21 à poids et les montres 7 et 28 à ressort de F. Berthoud ; les montres 14 et 10 de Louis Berthoud ; une montre d’Arnold. L’abbé Bertrand devait diriger les observations astronomiques, mais il fut victime d’une chute qu’il fit au Cap. En voulant gravir la montagne de la Table, il roula de 200 pieds de haut et se blessa si grièvement qu’on dut le laisser en Afrique australe ou il mourut au bout de quelques mois. L’ascension n’était pourtant pas difficile. La Caille l’avait décrite : « Elle se fait, dit-il, par une fente fort profonde qui est vers le milieu, un peu plus à l’occident. Elle commence aux deux cinquièmes de la montagne et est large de 50 à 60 pas, va en se rétrécissant jusqu’au sommet, elle est couverte de terre, de pierres et d’arbrisseaux. » La direction de la partie astronomique du voyage fut alors confiée au lieutenant de vaisseau Rossel qui s’en acquitta à la perfection. Le bénédictin Pierson et plusieurs officiers l’assistèrent. A son retour en Europe il refit tous ses calculs, sauf ceux d’angle horaire, en se servant des observations lunaires faites à Greenwich pendant la campagne. Les erreurs sur les longitudes déterminées à terre tombèrent alors à 3 ou 4’ tandis qu’elles atteignaient quelquefois 20 à 30’ par suite des erreurs des tables lunaires, ce qui fixe à 0°5 au maximum l’erreur des longitudes à la mer à ce moment ; mais il les obtenait en général à 15 ou 20’ près, en se servant de la Connaissance des Temps ou du Nautical Almanac. On réglait jusqu’alors les chronomètres par des hauteurs correspondantes ; on fit usage pendant ce voyage, dans le même but, de simples horaires par la hauteur.
![]()
D’autre part, sur les conseils de Borda, les latitudes furent déterminées d’une manière générale par des circumméridiennes afin de conserver aux cercles de son invention leur avantage principal : la répétition des angles. Beaucoup de latitudes furent aussi déterminées par deux hauteurs et le temps entre les deux observations. Le calcul se fit, comme nous l’avons déjà dit à propos du problème de Douwes, par approximations successives.
![]()
 La montre 14 fut excellente. On eu jugera par le tableau ci-dessous, dressé d’après les calculs de Rossel effectués au moyen des observations réduites avec les vraies valeurs des coordonnées de la Lune. La variation de 7s,4 de Ténériffe au Cap s’expliquait, d’après L. Berthoud, par l’habitude qu’on avait de porter la montre pendant le jour. Elle fut beaucoup plus régulière quand on eut pris le parti de ne plus le faire. On voit que l’erreur géographique est souvent plus grande que l’erreur à l’atterrissage, ce qui prouve que la marche ne variait pas avec une vitesse uniforme. A la mer, enfin, les longitudes obtenues par les montres et par les distances s’accordaient à l’ordinaire à moins de 10’. En 1814, Rossel résumait son opinion sur les montres en disant que « celles de F. et L. Berthoud avaient donné généralement la longitude à 30’ trois mois et qu’on en avait tiré parti pour le plus grand bien de la géographie et de la navigation depuis les voyages de Cook », mais qu’elles pouvaient éprouver des dérangements subits sans cause apparente, de sorte qu’il fallait les contrôler par des distances lunaires surtout avant l’atterrissage.
La montre 14 fut excellente. On eu jugera par le tableau ci-dessous, dressé d’après les calculs de Rossel effectués au moyen des observations réduites avec les vraies valeurs des coordonnées de la Lune. La variation de 7s,4 de Ténériffe au Cap s’expliquait, d’après L. Berthoud, par l’habitude qu’on avait de porter la montre pendant le jour. Elle fut beaucoup plus régulière quand on eut pris le parti de ne plus le faire. On voit que l’erreur géographique est souvent plus grande que l’erreur à l’atterrissage, ce qui prouve que la marche ne variait pas avec une vitesse uniforme. A la mer, enfin, les longitudes obtenues par les montres et par les distances s’accordaient à l’ordinaire à moins de 10’. En 1814, Rossel résumait son opinion sur les montres en disant que « celles de F. et L. Berthoud avaient donné généralement la longitude à 30’ trois mois et qu’on en avait tiré parti pour le plus grand bien de la géographie et de la navigation depuis les voyages de Cook », mais qu’elles pouvaient éprouver des dérangements subits sans cause apparente, de sorte qu’il fallait les contrôler par des distances lunaires surtout avant l’atterrissage.
![]()
Beautemps-Beaupré, qui faisait la campagne, donna en 1808, dans un appendice à la relation du voyage un « Exposé , peu systématique il est vrai, des méthodes pour lever et construire des cartes et plans », qui indique les procédés hydrographiques de l’époque ; sur lesquels on n’avait rien de satisfaisant jusque alors. Il y développe en particulier la méthode des « segments capables » qui lui a été inspirée, dit-il, par Dalrymple (1771) ; et il y fait un usage très étendu des « vues des côtes ».
![]()
Pendant que Dentrecasteaux travaillait dans le sud-ouest du Pacifique, le capitaine Marchand explorait la partie nord-est qui venait d’être visitée par Lapérouse. La circumnavigation du Solide, de 300 tonneaux de port, c’est-à-dire de 600 tonnes environ de déplacement, chevillé et doublé de cuivre et portant 50 hommes d’équipages, fut entreprise sur l’initiative, et, pour la moitié de leur valeur, aux frais de la maison Baux, de Marseille, qui désirait se livrer au commerce des pelleteries dans le nord-ouest canadien. Le Solide partit le 14 décembre 1790. Il doubla le cap Horn, explora la côte qui était le but principal de sa mission, toucha aux Sandwich, à Macao, à la Réunion et à Sainte-Hélène et rentra à Toulon le 14 aout 1792. Marchand était très entrainé aux observations et aux calculs des distances lunaires, ainsi que son lieutenant Chanal et ils ne cessèrent d’observer leur longitude à la mer. Au cours de leur voyage, ils la déterminèrent astronomiquement 70 fois environ. Fleurieu, qui s’appelait, en 1799, Claret Fleurieu et non plus Eveux de Fleurieu, discuta leurs observations à un point de vue nouveau. Il s’en servit pour faire une étude approfondie des courants dans les parties centrales des océans et il mit en relief, eu particulier, la compensation partielle des erreurs de l’estime qui se faisait généralement dans les longues traversées, par suite du changement de sens des courant le bâtiment était entrainé soit à l’est ou à l’ouest, soit au nord ou au sud de sa route estimée. Des Sandwich au sud de Formose, l’erreur résultante de l’estime fut de 6° 19’.
![]()
Les expéditions nationales continuèrent. On voulait suivre l’impulsion donnée par l’Angleterre et en 1800, le Géographe et le Naturaliste, auxquels se joignit plus tard la Casuarina, furent confiés au capitaine de vaisseau Baudin pour faire des découvertes dans les Terres Australes. Cette entreprise fut malheureuse à quelques égards, par suite des faibles qualités de marin de Baudin, mais la géographie y gagna beaucoup. Sur l’atlas joint au voyage de Dentrecasteaux, on remarque que la partie sud de l’Australie, entre le nord de la Tasmanie et l’archipel de Nuyts à l’ouest, est laissée en blanc. On dirigea donc Baudin surtout dans ces parages. D’après ses instructions, il devait s’assurer entre autres « de l’existence du détroit coupant l’Australie en deux portions en se reliant au golfe de Carpentarie ». Les travaux eurent lieu dans le détroit de Bass, à l’ouest de cette région et autour de l’île King. Les environs d’Adélaïde, d’Albany et la côte ouest d’Australie furent aussi soigneusement explorés, afin de compléter les travaux de Dentrecasteaux. Bissy et Bernier astronomes, avaient été embarqués. Ils avaient des éphémérides de la Lune rapidement calculées pour eux par Burckhardt, sur les tables de Burg. Henri Freycinet, alors lieutenant de vaisseau, fit simultanément les mêmes observations que Bernier. Les aspirants, enfin, avaient subi des examens difficiles pour être admis. Les longitudes absolues étaient observées au cercle et les montres marines servirent pour les lieux intermédiaires aux longitudes astronomiques. Au retour, en 1804, celles-ci furent corrigées, en tenant compte des erreurs des tables lunaires d’après les observations de Maskelyne à Greenwich et d’autres de Bouvard, de Méchain et de Burg. La montre 35, de Louis Berthoud, sans doute, car F. Berthoud n’en parle pas, leur meilleure, eut une marche qui ne varia qu’entre 20s,4 et 26s,3 d’octobre 1801 à avril 1803.
![]()
Par son manque d’habileté, Baudin fut presque partout devancé dans ses découvertes par la mission anglaise de Flinders, partie cependant d’Europe plusieurs mois après lui. Ils se rencontrèrent une fois à la Baie de la Rencontre (aujourd’hui Encounter Bay). Beautemps-Beaupré avait remarqué des variations de plusieurs degrés dans des déterminations rapprochées de la déviation. Il faisait dépendre du frottement des erreurs de l’ordre du degré et, pour le reste, il attribue simplement les inégalités à la grossièreté des compas, « dont l’imperfection était réellement déplorable », disait Freycinet. Nous savons qu’ils ne comportaient pas encore d’alidade. Flinders fut plus avisé et plus heureux. Il annonça, par des mesures systématiques, que les déviations étaient nulles au nord et au sud magnétiques, maxima à l’est et à l’ouest et il les déclara proportionnelles, à l’inclinaison magnétique dans le lieu, leur donnant la formule θ sin ζ. Il en attribua la cause au magnétisme induit dans les fers du navire et il proposa de les faire disparaitre par le choix d’un emplacement convenable du compas ou par un épontillage approprié, première idée du flinders de nos jours. Avant lui d’ailleurs, son compatriote Dowine avait vaguement pressenti, en 1794, qu’il fallait faire dépendre les inégalités constatées des masses de fer du navire. Avant eux enfin le Dieppois Guillaume Denis, dès 1666, avait vu que deux boussoles placées en deux points différents du même navire ne concordaient pas. D’autres avaient fait des remarques analogues et Walles, astronome de Cook, avait noté l’influence du cap sur la variation.
![]()
Il y eut ensuite un temps d’arrêt, jusqu’au voyage de Freycinet, devenu capitaine de vaisseau, sur l’Uranie. Il eut lieu de 1817 à 1820. Il se proposait de faire de l’hydrographie et de recueillir des observations sur la physique du globe concernant la météorologie, l’océanographie, l’étude des marées et le magnétisme. Ils visitèrent Rio de Janeiro, Bourbon, Timor, les Mariannes, d’où ils descendirent à Port-Jackson (Sydney), mais en faisant au départ une longue route à l’est jusqu’aux Sandwich ; enfin, les Malouines où l’Uranie se perdit. L’expédition rentra en France sur la Physicienne, que Freycinet acheta pour terminer son voyage en sécurité. Il n’y avait pas d’astronome à bord, les marins, depuis longtemps, pouvant suffire aux observations. Déjà Dagelet, en effet, du temps de Lapérouse, écrivait à Lalande que « les marins n’avaient plus besoin des astronomes à l’avenir parce qu’ils acquerraient l’habitude des observations de longitudes ». Les montres furent placées sous la direction de Lamarche, premier lieutenant de l’Uranie, qui observa chaque jour un angle horaire le matin et un le soir. De plus, à tour de rôle, deux angles horaires étaient observés également chaque jour, par un officier et par un élève de la marine. Les trois observateurs faisaient aussi la latitude à midi. On ne négligea aucune occasion d’observer des distances lunaires, et chaque officier était muni d’un cercle à réflexion et d’un horizon artificiel.
![]()
Ils avaient cinq chronomètres : quatre de Louis Berthoud et un de Bréguet. Quelques-uns eurent de fortes anomalies. Le 144 de Berthoud donnait, vers les Malouines, après une traversée de quatre mois, des longitudes qui différaient de 7° de celles qui étaient conclues du 150 de Berthoud et du 2.868 Bréguet. A terre, ils observaient des distances par séries de six.
![]()
Le voyage du capitaine de frégate Duperrey qui avait fait l’Uranie, sur la Coquille, suivit de près celui de Freycinet, puisqu’il s’effectua en 1822-1825 « pour l’étude des trois règnes de la nature, du magnétisme, de la météorologie et de la géographie ». Ils déterminèrent des longitudes avec les montres, soit à partir de stations principales déjà fixées et dont la détermination fut alors complétée par eux, soit partir de points entièrement situés par leurs observations. Leurs cercles étaient munis d’un petit appareil attribué à Borda et destiné à mesurer la dépression. Nous n’avons pu retrouver comment il était fait. Ils allèrent à Ténériffe, à Sainte-Catherine du Brésil, au Callao, à Tahiti, Port Praslin (Nouveau-Mecklembourg), Cajéli (île Bourou) et Amboine. Puis ils firent par l’ouest le tour de l’Australie, touchèrent Port-Jackson et passèrent ensuite aux Carolines, à Surabaya, enfin à l’Ile de France. Roussin avait mesuré 892 distances formant 223 séries pour fixer la longitude de Rio. Ils en prirent 306 en 51 séries de Ténériffe aux Malouines, en passant par Sainte-Catherine (à Anhatomirim, c’est-à-dire tête de petit singe) et ils conclurent des 1.198 distances et des marches de leurs montres 118 et 3.072 la valeur de 51° pour la longitude de ce dernier point. On admet aujourd’hui 50° 54’ 75". Au Callao, ils prirent 732 distances, à Cajéli 186. Jacquinot était l’officier chargé des montres, c’est-à-dire de la direction des observations astronomiques. Ils avaient les chronomètres 118 et 160 de Louis Berthoud, 26 de Motel, 3.072 et 3.377 de Bréguet, le dernier appartenant à Lesage, officier de l’expédition. Le 118 et le 3.072 ne furent plus utilisables à partir de janvier et de juin 1824. A la fin de l’année 1823, toutes les montres éprouvèrent en même temps des sauts brusques, à la suite, pensèrent-ils, d’orages très fréquents et violents. La marche du 26 passa alors de 10 à 26 secondes. Celle du 160 de 26 à 18 secondes. La plus grande erreur à l’atterrissage par la montre 26 fut de 10’ en 41 jours, de l’Ascension à Gibraltar, et, pour la durée moyenne des traversées, qui fut de 30 jours, la moyenne absolue des erreurs à l’atterrissage des bonnes montres ne fut que de 3’. Duperrey, enfin, put dresser une carte de la circulation superficielle des eaux dans le Pacifique, en utilisant les observations de courants faites pendant son voyage et par ses prédécesseurs.
![]()
Pour éviter de fortes déviations à ses compas, Duperrey avait fait enlever les canons du gaillard d’arrière de la Coquille et il avait fait cheviller et clouter en cuivre cette partie du bâtiment, destinée aux opérations magnétiques, dans un rayon de 10 à 12 pieds (3 à 4 m.). Il eut ainsi des déviations négligeables. En même temps que des observations du pendule, il fit des déterminations magnétiques complètes, utilisant en particulier la méthode des oscillations pour la mesure de la composante horizontale.
![]()
Le voyage que fit Bougainville le fils, de 1824 à 1826, sur la Thétis et l’Espérance, n’était pas spécialement destiné à la géographie ; il avait surtout pour but de « montrer le pavillon » et on se borna à y vérifier des positions. La Thétis et l’Espérance relâchèrent à Bourbon, Pondichéry, ou la Thétis se rendit par la route Grenier en 21 jours, du 9 au 30 juin, Singapour, Manille, Macao, Tourane, Sourabaya, Port-Jackson, Valparaiso, Rio. A Cavite, ils observèrent 1.632 distances en 408 séries, en calculant d’ailleurs les hauteurs pour la réduction, comme on le faisait d’ordinaire à terre, et ils obtinrent un résultat exact à 1’6 près. A Valparaiso, 756 distances en 189 séries leur donnèrent une erreur de 7’. Ils calculaient l’erreur moyenne de leurs résultats en employant la formule de Fourier .
![]()
![]() Ils employaient quatre montres : 29 et 140 de Berthoud, 3.201 et 3.588 Bréguet. Elles donnèrent à 1’ près pour la longitude de Rio, la même valeur que les distances lunaires, mais il y a 8’ de différence entre le nombre qu’ils adoptèrent et celui de la Connaissance des Temps.
Ils employaient quatre montres : 29 et 140 de Berthoud, 3.201 et 3.588 Bréguet. Elles donnèrent à 1’ près pour la longitude de Rio, la même valeur que les distances lunaires, mais il y a 8’ de différence entre le nombre qu’ils adoptèrent et celui de la Connaissance des Temps.
![]()
Nous terminerons par le voyage de Dumont d’Urville qui vit, avec l’Astrolabe, les débris de l’expédition de Lapérouse. Il avait déjà fait le voyage de la Coquille comme second de Duperrey. L’originalité de son expédition consista en ce que, au lieu de déterminer simplement des positions comme on l’avait fait sur la Coquille, il proposa des explorations suivies de côtes et d’archipels, et il fit de cette manière l’hydrographie des côtes de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Guinée. Jacquinot, son second, fut directeur des observations astronomiques. Il comprit très bien le nouveau point de vue. Leurs relâches furent courtes, de sorte qu’ils n’observèrent pour ainsi dire pas de distances lunaires destinées à fixer des positions absolues. Ils assujettissaient alors les positions déterminées par eux au moyen de leurs montres à des stations principales « obtenues en joignant les résultats des travaux des principaux navigateurs », se conformant ainsi, en somme, à peu près à la méthode de Borda et de Roussin sur les côtes d’Afrique. Ils avaient quatre chronomètres : 26 et 38 de Motel et 83 et 118 de L. Berthoud. Pendant la campagne, qui dura trois ans, de 1826 à 1829, seuls le 38 et le 83 furent assez réguliers, « sans avoir rien de très remarquable », pour avoir pu être utilisés tout le temps. Ainsi la marche du 38, qui était de 3s,2 à Toulon, le 26 avril, était passée à 30s,9 en janvier 1829, à l’Ascension, et sa variation avait été irrégulière.
![]()
Mais enfin Rossel, « dernier reste de l’illustre école de navigateurs parmi lesquels brillèrent Bougainville, Lapérouse, Dentrecasteaux, Fleurieu, Borda, Chabert », put faire l’éloge de leurs travaux hydrographiques. De toute façon, le mystère de la longitude était définitivement éclairci, et les marins la déterminaient couramment, comme ils manœuvraient leurs vaisseaux. Le temps était passé où, suivant le mot de Borda, « ils avaient appris à regarder le problème des longitudes comme à peu près impossible à résoudre, au moins pratiquement ».
![]()
On pouvait rappeler ici, quelques noms parmi ceux des savants qui déchirèrent le voile. Il était si bien soulevé du reste qu’en 1828 le Bureau des Longitudes, institué en Angleterre par l’acte de 1714, était supprimé. Il avait distribué 101.000 livres sterling. Dumont d’Urville se servait enfin des distances et des montres comme on le fit après lui et comme on le fait des montres de nos jours.
![]()
C’est ainsi que les astronomes, les artistes et les navigateurs dessinaient les contours du monde [3]. Le problème de la longitude à la mer était né avec les premiers grands voyages de découvertes. Il s’achevait avec ceux de la fin du XVIIIe siècle et du commencement du XIXe. Ceux-ci furent la conséquence naturelle et presque nécessaire des très longs travaux à la suite desquels on avait trouvé des solutions pratiques à la redoutable question. Sa signification complète ressort de ce rapprochement, et il éclaire, en les réunissant dans un même ensemble, quelles que soient leurs différences, les deux grands élans qui portèrent les hommes, à trois siècles d’intervalle, à parcourir les océans, pour connaître le globe auquel ils sont attachés et en étudier les ressources. Il est le lien qui unit Colomb, Gama et Magellan d’une part, Cook, Lapérouse et Dumont d’Urville d’autre part.


 Suivi RSS
Suivi RSS Conception
Conception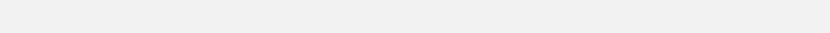


 Version imprimable
Version imprimable Publié Décembre 2014, (màj Décembre 2014) par :
Publié Décembre 2014, (màj Décembre 2014) par :





