LES ORIGINES ET LES DIFFÉRENTS ASPECTS DU PROBLÈME
Présentation
- Les grands voyages hauturiers sont entrés dans la pratique de la navigation aux environs de l’année 1500. Deux grands types de problèmes ont immédiatement surgi :
1° que le marin soit capable de déterminer à chaque instant sa position à la surface des mers ;
2° qu’il ait à son usage des cartes côtières et océaniques, exactes, afin d’y repérer sans erreur cette position.
On remarquera que dès problème se trouvera posé, pratiquement simultanément, des méthodes furent proposées. Curieusement, les méthodes certainement les plus difficiles en apparence à réaliser au début et les moins simples, au jugement des marins, c’est-à-dire celles qui avaient recours aux astres et aux horloges, devaient finalement triompher, au grand honneur des savants et des praticiens de génie, dont la ténacité finit par avoir raison du redoutable problème.
Pour lire ce dossier, dans sa version initiale (mise en page de 1931), télécharger le PDF de ce chapitre à ce lien
Le fac-similé dans la version de 1931, est ici
![]()
![]()
On peut faire commencer la navigation hauturière, chez les Européens, aux grands voyages de découvertes qui ont amené la reconnaissance des Indes occidentales et orientales, c’est-à-dire à la fin tout à fait du xve siècle. Du moins, c’est partir de cette époque que les voyages au long cours ont été entrepris en grand nombre, d’une manière permanente. Les Portugais, qui avaient reconnu auparavant la côte d’Afrique, s’avançaient simplement le long de cette côte ; et, comme les îles de l’Ascension et de Sainte-Hélène n’ont été découvertes qu’en 1501, et 1502, nous ne pouvons affirmer avec certitude qu’ils la quittaient quelquefois au retour.
Ce n’est qu’avec Diaz, en 1486, que nous sommes sûrs d’avoir un exemple de navigation en haute mer. On sait en effet que, parvenu par 26° de latitude sud en longeant la terre, il fit alors route au large pendant plusieurs jours ; mais bientôt, l’état si particulier de la mer et de l’atmosphère à la rencontre des eaux du courant des Aiguilles, venant du canal de Mozambique, et du courant froid de l’Atlantique sud, l’avertit qu’il devait avoir dépassé l’extrémité de l’Afrique, et il remonta au nord, ayant doublé, sans le voir, le cap de Bonne-Espérance. Si l’Afrique, au lieu de se prolonger jusqu’à la latitude de 35° seulement, s’était avancée, comme l’Amérique, de 20° plus au sud, Diaz aurait sans doute entrepris, en prenant le large, le plus long des voyages hors la vue de la terre accomplis jusqu’à lui.
- Christophe Colomb, en 1492, traversa l’Atlantique en 33 jours, du 9 septembre au 12 octobre, entre l’île de Fer et Guanahani. Mais le premier voyage de Vasco de Gama, cinq ans plus tard, paraît, au point de vue strictement maritime, beaucoup plus intéressant que tous ceux qui l’ont précédé. Nous n’avons pas, par des relations directes de membres de l’expédition, une connaissance absolument certaine de la route qu’il a suivie. Lorsque, après avoir quitté Santiago des îles du Cap Vert, il parcourut l’Atlantique sud pendant 93 jours avant d’atterrir à la baie de Sainte-Hélène, à deux degrés au nord du cap de Bonne-Espérance. Mais le Roteiro, publié à Porto en 1838 par Costa Païva, permet, semble-t-il, de rétablir cette route avec une très forte probabilité, sinon avec certitude.
- Gama quitta Santiago le 3 août 1497, et Velho, l’auteur présumé du Routier, parle d’abord de route à l’est. Le 18, ils s’estiment à 11 lieues seulement de leur point de départ ; et le 22, après 19 jours de mer, dont deux ont été employés à réparer une vergue de la capitane, ils pensent se trouver à 80 lieues au large. Ils font alors route au S. 1/4 S.- O., c’est-à-dire à 11° à l’ouest du sud. La route à l’est doit d’abord nous arrêter. Gama, comme ses prédécesseurs, avait-il alors l’intention de longer la côte d’Afrique et chercha-t-il à la rallier ? Mais au mois d’août, la région des calmes équatoriaux remonte jusqu’au Cap Vert et la navigation de la flottille fut sans doute très lente au début. Nous avons relevé dans le Journal du bord du bailli de Suffren qu’à l’aller son escadre mit 20 jours à franchir la zone des vents variables, avec une vitesse moyenne de 38 milles par jour ; qu’au retour, pendant 14 jours, il ne fit que 25 milles par 24 heures, soit 2 kilomètres à l’heure, dans les mêmes conditions.
- D’autre part, il est dit dans le Roteiro que Diaz « marchait de conserve avec eux jusqu’à Mina », point situé sur la Côte d’Ivoire. Or nous avons rappelé qu’en 1486 ce dernier avait quitté la côte d’Afrique avant le Cap. Il savait évidemment que le long de cette côte des vents debout régnaient en permanence, qui devaient les obliger à une navigation très longue et énervante ; et puisqu’il avait pris le large, onze ans plus tôt, il parait naturel d’admettre qu’il ait conseillé Gama de commencer à s’éloigner de terre dès le début de la traversée pour chercher, en plein Océan, des vents favorables, conduisant vite au but. Enfin le Roteiro, si attentif à noter les terres en vue, ne dit rien, jusqu’à la baie Sainte-Hélène, qui puisse faire supposer qu’ils s’étaient rapprochés d’un continent. Il ne contient rien en particulier qui indique qu’ils soient effectivement allés jusqu’à Mina.
- Ne peut-on penser, par suite, qu’après quelques hésitations en faisant route à l’est, la décision de prendre le large fut enfin adoptée, hypothèse qui expliquerait la direction S. 1/4 S-W, alors qu’on n’était encore, après 19 jours de mer, qu’à 80 lieues de terre.
- Est-il possible d’aller plus loin ? Si on prend pour date du départ de Gama celle du 18, on trouve qu’il a atterri à la baie Sainte-Hélène après 78 jours de route, durée absolument incompatible avec celle qu’exigerait le voyage le long des côtes de Guinée.
- Or, Dentrecasteaux, en 1791-1792, effectua avec des frégates le même voyage en 74 jours ; et Baudin, en 1800, avec des corvettes, le fit en 77. Ces durées, qui s’accordent exactement avec celles de la navigation de Gama, sont plus longues, par contre, que celles de la traversée ordinaire. C’est que Dentrecasteaux et Baudin ont obéi à l’impulsion instinctive d’aller trop à l’est pour passer l’Équateur. Or, faire de l’est dans cette traversée au lieu d’aller franchement au sud dès le départ des îles, pour couper l’Équateur par 25 ou 30° de longitude et non par 17° ou 11°, comme l’ont fait Dentrecasteaux et Baudin, c’est infailliblement allonger la durée du voyage, puisque, à proximité des côtes d’Afrique, on est d’abord dans les régions les plus sujettes aux calmes et ensuite dans la zone des alisés du S.-E. directement opposés la route.
- Comme Dentrecasteaux et Baudin, le Hollandais Van der Hagen, au commencement du XVIIe siècle, met 75 jours des îles du Cap Vert au cap de Bonne-Espérance. Cependant d’autres navigateurs hollandais savaient et écrivaient, vers 1600, que des îles du Cap Vert au Cap, la « route était au S. W. et au S. W. ¼ S. » et que du cap Palmas au Cap « la route était par le large et en courant la bande du S. W. ¼ S. ».
- Il y eut en effet de très nombreux voyages hollandais aux Indes Orientales vers 1600. Très souvent les bâtiments devant doubler le Cap relâchaient au fond du golfe de Guinée, au cap Lopez ou à l’Ile du Prince ou à Annobon. Ils recherchaient surtout les petites îles où les garnisons portugaises étaient trop faibles pour pouvoir les empêcher de se rafraîchir. Puis ils couraient à l’W. jusqu’aux Abrolhos, sachant bien que le voyage le long de la côte d’Afrique était quasi impossible.
- Gautier Schouten de Harlem raconte qu’en 1658, lors de son premier voyage à Batavia. un bâtiment qui marchait de conserve avec le sien perdit six semaines sur ce dernier, pour avoir fait route à 22°, 5 à l’est de lui après le Cap Vert
- Granpré rapporte l’exemple d’un navire qui dut à la même erreur de rester 11 mois en route pour aller de France à la côte d’Angola par 12° de latitude sud.
- On peut donc aller jusqu’à penser que Gama commit la petite erreur de Dentrecasteaux et de Baudin. Toutefois, c’est par une intuition géniale qu’il changea sans doute sa route primitive et que, se lançant au milieu d’un océan tout à fait inconnu, il découvrit, dès la première traversée aux Indes orientales, à très peu près, la route qui devint classique après lui. Si on remarque qu’il la tentait sans avoir aucun renseignement sur le régime des vents qui règnent entre les îles de la Trinité et de Tristan d’Acunha à proximité desquelles on passe, et le sud de l’Afrique, et qu’il allait dans des parages où personne ne s’était encore risqué, on admirera sa magnifique audace, qui a si parfaitement réussi.
![]()
D’ailleurs que ces inductions soient ou non exactes, l’itinéraire des successeurs de Gama n’est plus douteux. Cabral, en particulier en 1500, afin d’éviter les calmes de la côte de Guinée, et les vents de S.-W. qui soufflent entre les caps Palma et San Lopez, et sur les conseils de Gama, paraît-il, alla tellement dans l’ouest, qu’il atterrit au Brésil, vers 10° de latitude sud, point d’où il gagna le cap de Bonne-Espérance.
![]()
Les grands voyages hauturiers étaient donc entrés dans la pratique de la navigation aux environs de l’année 1500. Mais, si aujourd’hui même, la mer, parcourue et étudiée partout, impose au navigateur qui doit se mettre à l’abri de ses surprises, une veille continuelle, on conçoit combien ces premiers hommes qui perdaient la terre de vue pour de longs jours dans des conditions hygiéniques qui leur faisaient traverser de dures souffrances, devaient désirer des moyens de sauvegarder leurs vies et d’abréger leurs voyages.
Pour l’étude que nous désirons entreprendre, ces moyens comportent deux ordres de choses, très solidaires comme nous le verrons. Il faut :
- 1° que le marin soit capable de déterminer à chaque instant sa position à la surface des mers ;
- 2° qu’il ait à son usage des cartes côtières et océaniques, exactes, afin d’y repérer sans erreur cette position.
Ainsi le problème du point à la mer, au large, a dû naître avec le long cours. C’était l’opinion des écrivains maritimes d’autrefois. Il devait se poser avec la navigation océanique ; tandis qu’il serait resté sans doute inexistant si la navigation avait continué à se borner aux mers intérieures. D’après Chabert, même à la fin du XVIIe siècle, on évitait autant que possible, en Méditerranée, de « faire canal », c’est-à-dire de perdre les terres de vue ; et on naviguait encore dans cette mer en allant de cap en cap, sous la conduite de pilotes régionaux. De telles pratiques ne pouvaient évidemment en rien faire avancer la science de la conduite du navire.
Mais le problème du « point » comporte, lui aussi, deux recherches de difficultés très différentes. L’une est la détermination de la latitude ; l’autre, celle de la longitude. Or, de tout temps, les marins ont pu aisément trouver leur latitude par des observations méridiennes faites d’abord à l’ « astrolabe » qui était devenu d’un usage courant au XVe siècle ; plus tard à l’anneau astronomique et à l’ « arbalestrille ». Il leur suffisait de tables de déclinaisons du Soleil et de quelques autres astres. Or les tables Alphonsines, parues en 1252, étaient imprimées en 1483 à Venise puis en 1488, 92, etc. ; celles de Bianchini en 1495. Nous en énumérerons d’autres. Il n’y avait donc aucune difficulté de ce côté.
- L’astrolabe était une simplification de l’astrolabe des Grecs, que les Arabes avaient enrichi de tracés nouveaux, et qui était devenu ainsi comme une sorte d’éphéméride et une machine à calcul. Il était décrit déjà, semble-t-il, dans le Arte de Navegar de Raymond Lulle vers 1295 ; à moins qu’il ne fût là question que d’un nocturlabe. Son emploi sur mer fut vraisemblablement vulgarisé sur l’initiative de Jean de Portugal qui réunit vers 1484 une junte, dont faisait partie, d’après Barros, historien portugais du XVIe siècle, Martin Behaim, auteur d’un globe célèbre daté de 1492, laquelle était chargée de construire un astrolabe, de calculer des tables de déclinaisons du Soleil et d’enseigner aux marins la manière de naviguer par la hauteur du Soleil.
Cet astrolabe se fixait au grand mât. Nous reviendrons sur le sujet. En fait, le journal du premier voyage de Colomb contient un grand nombre de déterminations de latitudes et, pour ne citer qu’un nom, un siècle plus tard, nous trouvons mention de l’astrolabe et d’un « cercle astronomique » dans le voyage de Barentz au Spitzberg et à la Nouvelle Zemble en 1597…
- Il n’en allait pas de même pour la longitude. Astronomiquement elle est égale à la différence des angles horaires ou des temps simultanés d’un même astre dans le lieu origine des longitudes et dans le lieu de l’observation. On pourrait donc l’obtenir en trouvant le moyen, étant en un lieu, d’avoir l’angle horaire d’un astre dans un autre lieu.
- Presque aussitôt la question posée, dès le commencement du XVIe siècle, elle a été résolue en principe ; c’est-à-dire que les moyens qui, en fait, mais après plus de 250 ans de travaux, ont donné la solution cherchée, se sont présentés immédiatement à l’esprit des savants. On en trouve en effet l’indication dans les écrits des astronomes, des géographes et des navigateurs, dès la fin du XVe siècle. Colomb et Vespuce ont essayé d’employer les méthodes lunaires et les conjonctions des planètes, pendant le cours de leurs voyages.
- Ainsi, le 13 janvier 1493, à Haïti, Colomb cherchait un port sur pour observer tranquillement la conjonction du Soleil et de la Lune et l’opposition de la Lune et de Jupiter « qui, généralement, cause beaucoup de vent ».
- Il observa aussi des éclipses de Lune. Par exemple le 14 septembre 1494 au Cap Oriental d’Haïti, il donna, par une telle observation, à ce cap une longitude de 9 heures par rapport au Cap Saint-Vincent ; longitude qu’il faut du reste ramener à 5 h. 1/2 si on tient compte d’une erreur de calcul qu’il commit. La longitude exacte est 4 heures.
- Et il observa une nouvelle éclipse de Lune le 29 février 1504 à la Jamaïque, au Puerto de Sauta Gloria. Vespuce, le 23 aout 1499, observa une conjonction de la Lune et de Mars, prédite par Régimontanus pour minuit juste à Nuremberg. Il trouva que la Lune faisait 1° par heure par rapport à Mars, quantité certainement trop forte, et qu’elle en était à 5°,5 à l’est à minuit, d’où il conclut sa longitude de 82°,5 ouest.
- Ajoutons qu’en 1520, Andres de San-Martin, le pilote le plus instruit de Magellan, observa des conjonctions, d’après les conseils de Faleiro qui avait écrit un traité des longitudes pour l’usage particulier de l’expédition. Ce traité contenait des préceptes pour trouver la longitude par la déclinaison de la Lune, les occultations d’étoiles, la différence des hauteurs de la Lune et de Jupiter, les oppositions de la Lune et de Vénus. De plus A. de San Martin se servait encore des éclipses et des distances du Soleil à la Lune.
- Les éclipses et les distances lunaires sont d’ailleurs recommandées par Alonzo de Santa Cruz, cosmographie de Charles-Quint, au commencement du XVIe siècle et l’avantage des méthodes lunaires est parfaitement reconnu par Vespuce lorsqu’il le voit dans le « corso piu leggier » du satellite. Diaz, Colomb, Vespuce, se servaient des éphémérides de Régimontanus pour les années 1475 à 1506 et le Calendarium eclipsium pour les années 1483 à 1530 était très répandu parmi les Portugais et les Espagnols. Les conjonctions de la Lune et des planètes, ou des planètes entre elles restèrent longtemps en honneur. Par exemple les grandes conjonctions de Jupiter et de Saturne « qui étaient à redouter à cause du grand refroidissement qu’elles produisent ». Citons plus tard, le 24 janvier 1597, l’observation d’une conjonction de la Lune et de Jupiter prédite par Joseph Scala pour Venise, faite par les Hollandais à la recherche du passage du N. E. Ils en conclurent entre Venise et la Nouvelle Zemble, une différence de longitude de 75°, alors qu’il y en a 45 seulement.
![]()
- Mais arrivons aux astronomes.
- En 1514, Werner, né à Nuremberg en 1468, dans sa Géographie de Ptolémée, parle de l’usage de la Lune pour les longitudes à la mer ;
- Apian, né en 1495 à Leysmich en Misnie (Saxe), signale dans sa Cosmographie la méthode des distances de la Lune aux étoiles. Il pense aussi que les éclipses de Soleil seront le meilleur moyen d’avoir la différence des méridiens.
- Gemma Frison ou Frisius, mort en 1558, parle également des distances lunaires, vers 1530, dans son traité sur le Ray astronomique et géométrique.
- Et, d’autre part, Delambre cite de lui le curieux texte suivant, qui prouve que l’idée de l’emploi des montres était aussi née cette époque. Il s’agit d’une « nouvelle invention pour les longitudes », où on relève ce qui suit : on commence, dit-il, à se servir de petites horloges qu’on appelle montres. Leur légèreté permet de les transporter. Leur mouvement dure 24 heures et plus longtemps pour peu qu’on les aide. Et elles offrent un moyen bien simple pour trouver la longitude. Avant de vous mettre en route, mettez soigneusement votre montre à l’heure du pays que vous allez quitter ; apportez toute votre attention à ce que la montre ne s’arrête pas en chemin. Quand vous aurez ainsi marché, prenez l’heure du lieu avec l’astrolabe, comparez cette heure à celle de votre montre et vous aurez la différence de longitude. »
- Ces montres, d’après Berthoud, avaient un ressort moteur et un échappement à roue de rencontre. Nous verrons ce que valait ce moyen à la mer 150 ans plus tard, avec des montres grandement perfectionnées relativement à celles dont il est ici question.
- Ajoutons seulement ici que Barentz passe pour le premier navigateur à avoir essayé de se servir des montres.
- On retrouve de semblables idées chez beaucoup d’autres auteurs échelonnés dans le XVIe siècle et au commencement du XVIIe ; par exemple chez Vernier, chez Nonius, géographe portugais à qui on doit l’idée précise de la loxodromie ; chez Métius, chez Longomontanus, élève et assistant de Tycho-Brahé à l’observatoire de Ilween, où il réunit beaucoup d’observations de la Lune ; enfin chez Képler.
- L’un d’eux mérite une mention spéciale ; mais ses propositions ont attendu plus d’un siècle avant de recevoir un commencement d’exécution. Il se nommait Morin. Né en 1583, à Villefranche en Beaujolais, docteur en médecine et professeur de mathématiques au Collège Royal, il annonça, en 1634, qu’il avait découvert le secret des longitudes. Il faisait hommage de sa découverte à son souverain, le laissant l’arbitre de la récompense qu’il croyait mériter. Astrologue et partisan de l’immobilité de la Terre, il ne croyait pas aux horloges et disait, à leur propos, « qu’il ne savait si le diable viendrait à bout d’une horloge à longitude, mais que c’était folie aux hommes que d’y penser ». Pézenas, en 1785, dans son Histoire critique de la découverte de la Longitude, Montucla, Delambre, lui consacrent de longues notices à l’occasion de ses interminables débats avec les commissaires que nomma Richelieu pour examiner sa découverte. De la Porte, intendant général de la marine et du commerce, en était le président ; le président Paschal, Mydorge, Beaugrand, Boulenger et Hérigone étaient commissaires-juges ; enfin on leur avait adjoint quelques capitaines de vaisseau : de Cam, Treillebois et Letier. Morin expose que ses prédécesseurs n’ont examiné l’usage de la lune pour les longitudes que dans des cas particuliers ou qu’ils ont négligé des corrections importantes. C’est ainsi que Képler et Longomontanus ont prescrit de mesurer la distance de la Lune à une étoile, seulement quand la Lune est au nonagésime, c’est-à-dire au point d’intersection de l’écliptique et du vertical du pôle de ce grand cercle. Si la Lune est dans l’écliptique, la ligne des cornes est perpendiculaire à ce plan ; et si elle est en même temps au nonagésime, cette ligne des cornes est verticale, ce qui donne le moment de l’observation proposée. Or, dans ce cas particulier, le lieu vrai de la Lune étant toujours dans le vertical du lieu apparent, la parallaxe en longitude est nulle, et il n’y a pas besoin d’évaluer cette quantité pour réduire la distance. Tandis que Gemma Frisius et les autres négligeaient complètement la parallaxe, Morin, par contre, voulait des méthodes générales, correctement traitées, et il donna effectivement des solutions exactes des différents problèmes de trigonométrie sphérique qui permettent de déduire la longitude de la Lune des observations de cet astre susceptibles de conduire à ce résultat. Il suffit pour cela de pouvoir situer la Lune par rapport aux étoiles et Morin examina comment on pourrait le faire, entre autres, en observant sa hauteur ou son azimut, ou l’heure de son passage au méridien ou de son passage par le vertical d’une étoile connue ; enfin sa distance à une étoile.
- Au point de vue purement géométrique, ses méthodes étaient correctes et complètes. Il les appréciait même assez justement les unes par rapport aux autres, puisqu’il proposait de ne retenir à la mer que la méthode des distances et celle des hauteurs, en donnant, il est vrai, la préférence à cette dernière, qui a été remplacée par celle-là, non sans lutter du reste, ainsi que nous le dirons.
- Pour réduire la distance apparente à la distance vraie, il employait le moyen direct qui consiste à calculer l’angle au zénith dans le triangle apparent formé par le zénith et les positions apparentes des astres ;
- et à en conclure ensuite la distance vraie dans le triangle vrai dans lequel on connaît dès lors les côtés verticaux, qui sont les distances zénithales vraies, et l’angle compris.
- Mais la difficulté n’était pas dans tous ces exercices de géométrie, qui étaient à la portée de tous les astronomes. Elle résidait entièrement dans les deux entreprises qui n’ont été achevées qu’au siècle suivant et qui étaient, d’une part :
- l’établissement de tables lunaires exactes permettant d’avoir à l’avance des éphémérides de cet astre auxquelles il fût possible de comparer le lieu de la Lune déduit de l’observation,
- d’autre part la construction d’un instrument d’observation suffisamment précis. C’est ce que les commissaires objectèrent à Morin. Celui-ci répondit en proposant de mesurer les hauteurs et les distances avec un quart de cercle. Il pensait qu’un instrument de un ou deux pieds de rayon, muni d’un vernier au quart de minute suffirait, et il admettait entre autres encore, que puisque deux onces de plomb suffisaient à arrêter le mouvement des boussoles et une livre de cuivre celui d’un astrolabe, cent livres, attachées à un quart de cercle, le maintiendraient immobile. Mais les marins restaient sceptiques. Ils finirent cependant par convenir qu’avec un quart de cercle lesté on pourrait prendre hauteur à la mer à 4 ou 5’ près. Enfin, pour perfectionner les tables lunaires, Morin eut l’idée de la fondation d’un observatoire destiné à accumuler des observations.
- En résumé, il avait surtout résolu la seule partie du problème qui pouvait l’être par n’importe qui. Il a fait un peu plus toutefois en pensant à établir un observatoire ; et comme il avait eu aussi l’idée d’adapter une lunette à l’alidade de son quart de cercle et qu’il avait été un des premiers à voir des étoiles en plein jour, les commissaires auraient dû légitimement l’encourager, au lieu qu’ils rendirent contre lui une dure sentence. Le public, en général, prit parti en sa faveur, mais un Écossais, Hume, lança un pamphlet qui débutait par ces mots : “parturient montes, nascetur ridiculus mus”.
- Plus tard Morin s’adressa, parait-il, aux États de Hollande pour obtenir le prix promis par eux au premier inventeur de la science des longitudes ; mais on ne voit pas qu’il ait reçu une réponse. Enfin Mazarin, en 1645, finit par lui attribuer une pension de 2.000 livres qu’on s’est accordé, par la suite, à trouver méritée. En 1778, les commissaires de la Flore lui rendirent hommage en écrivant « qu’avant lui personne n’avait proposé sur les mouvements de la Lune une méthode raisonnable en toutes ses parties » et ils pensaient que ses ouvrages « contenaient au moins le germe de tout ce qui à été dit depuis sur cette matière ». Mais c’est surtout de Fouchy, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences, qui l’a fait sortir de l’oubli. En 1783, il parla avec enthousiasme de sa Science des Longitudes, disant que Morin avait « complété et démontré le premier ce qui avait été dit avant lui ». Il rappela surtout son heureuse idée d’adapter une lunette aux instruments. La lunette de Morin, d’ailleurs, ne pouvait pas porter de réticule, car elle avait un oculaire concave qui ne s’y prêtait pas
![]()
En réalité, la question n’avançait pas et les indications qui précèdent n’ont qu’un seul intérêt : celui de montrer que le problème était bien posé et qu’on prévoyait dans quel sens il pouvait être résolu. Dés lors, les savants savaient comment orienter leurs efforts ; ils étaient prêts a faire profiter la science nautique des progrès réalisés en astronomie et en horlogerie ; et réciproquement le désir de découvrir la longitude devait accélérer ces progrès.
![]()
Il n’était pas besoin de donner quelques exemples, comme nous l’avons fait, pour montrer tout ce que ces procédés par l’astronomie ou par les horloges avaient d’impraticable à l’époque des premiers grands voyages de découvertes et dans le cours du XVIe siècle. Il eût fallu une astronomie, une physique, une technique infiniment plus avancées qu’elles ne l’étaient. Et si ces méthodes firent naître des illusions, ces illusions ne tardèrent pas à faire place à une simple déception ainsi qu’il résulte de textes contemporains. Même au XVIIe siècle et pendant la plus grande partie du XVIIIe, elles ne pouvaient, pratiquement, conduire à aucun résultat sur lequel on pût compter.
- Il nous suffira pour le XVIIe de voir où elles en étaient en résumant l’énorme et pittoresque chapitre que dans son Hydrographie le P. Fournier consacre à la longitude et de dire comment il en jugeait. Il énumère et discute un grand nombre de méthodes, donnant pour les éprouver des exemples où le scepticisme, pour le moins, perce toujours.
- Une première méthode, dit-il, est par l’observation simultanée d’une même éclipse en différents lieux. Et il cite l’éclipse de Lune du 23 septembre 1577, d’où il résulta entre Tolède et Mexico une différence de longitude de 99 à 100° (la différence exacte est de 95°).
- Une deuxième consiste à prédire l’éclipse pour un lieu et à l’observer dans celui dont on veut la longitude par rapport au premier.
- Une troisième moyen est celui de l’observation des conjonctions de la Lune avec les planètes ou avec les étoiles ; méthode qu’il avoue « difficile et facheuse » en pratique à cause des parallaxes et parce que les mouvements des planètes ne sont pas bien connus.
- En quatrième lieu il cite la méthode par le vrai lieu de la Lune, « méthode ancienne, dit-il, dont on ne connaît pas l’auteur » et qu’il juge en ajoutant, après avoir rappelé qu’on peut observer dans des cas particuliers où la parallaxe en longitude n’intervient pas, qu’on ne peut « rien espérer de tout cela ». Puis il donne, d’après Hérigone, l’observation du passage de la Lune au méridien en même temps qu’une étoile, d’où on conclura l’ascension droite de la Lune ; ou celle de la hauteur d’une étoile, pour avoir son angle horaire, au moment où la Lune est au méridien ; mais Hérigone lui-même avoue que ces deux méthodes « ne peuvent servir en pratique ». En fin de compte il conclut sévèrement par ces mots contre les purs théoriciens : « S’il y a chose au monde où l’on connaisse combien la spéculation est différente de la pratique, je crois que c’est en la matière dont je traite de présent plus qu’en toute autre. » Et la réformation de la longitude par les éclipses en particulier, même à terre, lui semble inutile parce qu’on ne peut l’exécuter sans commettre des fautes plus grandes que celles des cartes. Il en donne de nombreux et curieux exemples :
- Entre Tolède et Uranibourg, Tycho, par l’éclipse de Lune du 26 septembre 1577 met 14°,25 de longitude et il y en a, dit-il, 19 ou 20 par les itinéraires (en réalité la différence est de 16°,5).
- Une éclipse de mars 1635 met Paris et Londres sur le même méridien (il les croit à 3°).
- Une autre d’août 1635 met 7°,5 entre Rome et Naples par son commencement et 9° par sa fin.
- Et il s’étend sur les causes des erreurs. Elles proviennent : des erreurs sur l’appréciation des commencements et de la fin, erreurs qui vont à 24’ entre différents observateurs ; des erreurs sur le temps local déterminé de jour par le Soleil, de nuit par une hauteur d’étoile, de planète ou de Lune ; elles sont dues surtout à ce que les astronomes « ignorent encore le vrai mouvement de la Lune ». En suivant Tycho en effet on peut se tromper de 10’ sur le lieu du satellite soit de 5° sur la longitude. D’ailleurs Képler diffère de Tycho. Les tables alphonsines et pruténiques (celles-ci dues à Reinhold) fondées sur les observations et les calculs de Copernic dépassent 1° d’erreur. Chez Lansberg les erreurs vont à 30’, à 57’, à 63’. Il cite encore Hérigone. D’après ce dernier dont les éphémérides sont fondées sur les calculs de Copernic et de Tycho, il ne doit y avoir aucune éclipse de Lune en 1622. Or Gassendi en a observé une à Aix les 28-29 novembre de cette année. En 1625 Hérigone encore commet une erreur de 26’ sur la prédiction du commencement de l’éclipse de Lune du 23 mars ; de sorte que cette façon de trouver les longitudes par une éclipse prédite est « entièrement inutile sur mer ». Il faut aussi tenir compte de la « petitesse et rudesse » des instruments. Il n’est donc pas possible « d’obtenir par la voie du ciel la différence de longitude, qu’on ne fasse de nouveau quantité d’observations très justes et qu’on n’ait des tables desquelles une longue expérience fasse connaitre qu’il n’y a rien à redire ».
- Il semble toutefois un peu moins pessimiste en ce qui concerne l’usage des horloges ; mais c’est tout relatif. Il remarque en effet que Tycho, quelque soin qu’il ait pris, n’a jamais eu satisfaction par ses horloges. D’ailleurs les horloges à roues s’altèrent dans les grands voyages et il leur préfère des « poudriers faits de sable d’argent ou d’étain de glace calciné, qui résiste mieux que le sable de mer ou la poudre de coque d’oeufs ». Il cite le cas du pilote Jean Gondrain, de La Rochelle, qui avait un poudrier de 24 heures avec lequel il cherchait les longitudes en le réglant aux midis des lieux de ses départs. Mais là encore et bien qu’il ajoute, à cause, semble-t-il de la simplicité apparente du procédé, remarquant qu’il est plus facile de se servir d’une horloge que d’un instrument géométrique, que « si on donne ordre à perfectionner les horloges il n’y a aucune pratique qui lui soit comparable » (et en somme il avait raison), il finit par une négation : « on doute si un démon pourrait faire une horloge si juste qu’il serait nécessaire ». Or ces jugements étaient portés vers 1650.
- Ce n’est pas qu’il renonce à trouver une solution. Il en avait une au contraire, qui avait l’avantage de la simplicité et qui était de plus la seule, à l’époque, à pouvoir rendre quelques services effectifs.
- Puisque les moyens astronomiques ne pouvaient réussir il fallait en effet se rejeter sur des moyens purement terrestres et naviguer sans rien demander au ciel. Aussi le P. Fournier, qui avait beaucoup navigué, s’abandonne-t-il en désespéré à l’estime : « la modeste estime », et lui donne-t-il toute la confiance qu’il refuse aux observations astronomiques. C’est que l’estime n’avait pas pour ces navigateurs d’autrefois la signification et la valeur que nous sommes portés à lui attribuer aujourd’hui, à la suite d’habitudes déjà anciennes. Il faut, ici, nous affranchir de nos idées et de nos points de vue actuels et juger du passé en hommes du passé et non pas du présent. L’estime depuis longtemps nous sert seulement à relier des points astronomiques en général assez rapprochés et aussi comme première approximation dans un calcul de point astronomique pour faciliter ces calculs. En ce qui concerne la longitude au moins, ces rapports entre l’estime et le point astronomique n’existaient pas pour les navigateurs des XVe, XVIe et XVIIe siècles et même la plupart du temps pour ceux du XVIIIe : pour eux la longitude estimée était la longitude tout court, elle avait quelque chose d’absolu, d’incontrôlable.
![]()
Le problème était facile à concevoir pour le commun des navigateurs d’alors, hommes souvent ignorants et si l’on n’avait pas les moyens de bien déterminer les éléments du problème c’est-à-dire les routes, les dérives et les courants, en direction et en vitesse, on pouvait en somme à bon droit alors, étant donné la grossièreté des instruments astronomiques et l’imperfection notoire des éphémérides, espérer qu’on parviendrait plus aisément à mesurer correctement des vitesses et des angles sur terre, qu’à assujettir les mouvements célestes à des règles sûres et exactes, et à en tirer parti.
![]()
C’est ce qui explique sans doute qu’au cours du XVIe et du XVIIe siècle la question de la loxodromie ait suscité tant d’efforts et qu’on ait pu fonder de très grandes espérances sur la solution pratique du problème de l’estime qui était, comme nous le verrons, définitivement acquise au commencement du XVIIe siècle, grâce aux travaux de Nonius, de Mercator, de Wright surtout. Ces réflexions, nous semble-t-il, font comprendre des passages comme ceux qui suivent, extraits encore du chapitre sur la longitude chez le P. Fournier : « C’est chose étrange d’entendre parler et lire les ouvrages de certaines personnes qui ont toujours demeuré dans leurs études sans savoir ce qui se pratique sur mer. Presque tous ont en tel mépris ce moyen icy (de l’estime) qu’à peine l’estiment-ils digne d’être réfuté. Toutefois, les belles spéculations que j’ai déduites… n’ont jamais aidé aucun pilote sur mer… » ; alors que « cette pratique qui est chez les beaux esprits tant dans le rabais est celle qui a enrichi notre Europe des mines et pierreries de l’Occident et des épiceries de l’Orient ; et si vous l’ostiez aux pilotes de l’Europe, pas un n’oserait monter sur mer. Je suis donc d’un avis bien différent ». Et il ajoutait « Par les moyens de l’estime vous faites une estime du degré de longitude où vous êtes parvenu, qui se trouve d’ordinaire si précis, quand il est judicieusement fait, qu’ou n’en viendrait pas à une plus grande précision par aucune voye mathématique ; les pilotes y sont si duits et y ont telle croyance qu’ils n’ont aucune difficulté d’y hasarder leurs vies et leurs moyens. » « Encore en 1635 est arrivé à Dieppe un vaisseau qu’on avait envoyé à l’île Morice, distante de plus de 1.300 lieues, à laquelle est arrivé heureusement le pilote sans qu’il y eut jamais esté… Je doute fort si ceux qui se fient tant sur leurs opérations astronomiques, oseraient avec leurs instruments, de tels voyages. » Et il avait raison, pour le temps dont il parlait. Quelque grossière et incertaine qu’était alors l’estime et qu’elle continue d’être relativement, elle était infiniment plus satisfaisante que les moyens astronomiques qui devaient finalement triompher mais pas avant la fin du XVIIIe siècle et après les immenses travaux que nous nous proposons d’exposer ; car le problème a passionné le monde savant et au XVIIIe siècle plus encore qu’aux siècles précédents. Et nous verrons qu’en fait si ce XVIIIe siècle a marqué le succès définitif des méthodes astronomiques et par les horloges, le XVIIe a été par contre le siècle qui a vu la solution complète, graphique et algébrique du problème loxodromique ; c’est celui ou ce problème est devenu d’un usage courant chez les marins.
![]()
Mais il y avait une deuxième méthode basée sur des observations uniquement terrestres, qui fut découverte dès les premières navigations en haute mer. Elle consistait à déterminer la longitude par l’observation de la déclinaison de l’aiguille aimantée, moyen qui a eu, comme nous le dirons, une très longue histoire. La première idée en revient incontestablement à Christophe Colomb ;
- la première application aussi. D’abord il découvrit que la déclinaison [1] variait avec le lieu, cela dès son premier voyage, le 13 septembre 1492. Ce jour-là, au coucher du Soleil il remarqua que les boussoles qui jusque-là variaient au N. E. se dirigeaient un quart de vent au N. W. Il note aussi que la déviation avait augmenté le matin suivant. Or, dans son second voyage, au retour, étant resté par des latitudes trop faibles vers 20 à 22°, il n’avait pu s’élever vers l’est. Les provisions diminuaient et les huit on dix pilotes de l’expédition ne savaient où ils étaient. Mais Colomb remarqua que les boussoles, à mesure qu’ils avançaient, tournaient vers le N. E., après s’être dirigées vers le N. W. Il vit dans ces variations, qui avaient tant effrayé les pilotes lors de son premier voyage en leur faisant juger dangereux l’usage de la boussole, le salut de la flotte. Il en conclut en effet qu’ils étaient à un peu plus de 100 lieues à l’W. des Açores puisque c’était là qu’il avait trouvé la ligne sans variation.
- Dès lors la méthode était créée et ne fut plus abandonnée pendant trois siècles. Dès le début du XVIe siècle, vers l539, Alonzo de Santa Cruz eut le premier l’idée de construire des cartes de déclinaison magnétique, cartes qu’il traça effectivement et bien que la méthode ait été qualifiée par Gilbert, avec son autorité, de pensée chimérique de Baptiste Porta de Naples et de Livio Sanuto, nous verrons quels immenses et, en somme, utiles travaux elle a suscités.
![]()
Nous allons maintenant étudier une à une les différentes méthodes indiquées ci-dessus et nées, on le remarquera, à peu près simultanément, aussitôt le problème posé ; et nous montrerons comment et pourquoi les méthodes certainement les plus difficiles en apparence à réaliser au début et les moins simples, au jugement des marins, c’est-à-dire celles qui avaient recours aux astres et aux horloges, devaient finalement triompher, au grand honneur des savants et des praticiens de génie, dont la ténacité finit par avoir raison du redoutable problème.
![]()
![]()


 Suivi RSS
Suivi RSS Conception
Conception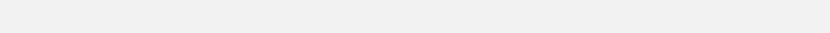


 Version imprimable
Version imprimable Publié Octobre 2014, (màj Novembre 2014) par :
Publié Octobre 2014, (màj Novembre 2014) par :





