LA LONGITUDE ET LES MARINS
Présentation
Des habitudes et des pesanteurs culturelles : on peut comprendre que les pilotes enracinés dans leur savoir-faire empirique, et pouvaient-ils faire autrement, aient résisté aux théories des calculs lunaires ou de la recherche de la longitude. Ils remettaient même en cause les règles de nœuds du loch, c’est dire !!!
Il en allait tout autrement du corps des officiers, car d’après Fleurieu :
- « On ne saurait trop inviter les officiers à se familiariser avec les observations astronomiques », disait-il en 1773 ; puis il critiquait les pilotes et reprochait aux officiers leur obstination à ne pas se mettre à l’ouvrage.
C’est par la formation que l’on s’en sortira, et c’est à quoi s’attelèrent les Académies : l’Académie de Marine, mais aussi l’Académie des Sciences et même l’Académie française !!!
Pour lire ce dossier, dans sa version initiale (mise en page de 1931), télécharger le PDF de ce chapitre à ce lien
Le fac-similé dans la version de 1931, est ici
Les astronomes et les artistes avaient donc résolu le problème de la longitude. La contribution des astronomes, en particulier, était immense. Ils avaient trouvé les dimensions de la Terre, crée des instruments, construit des tables de mouvements célestes, donné les moyens de résoudre les problèmes qui s’étaient posés. Sans eux, il ne pouvait être question de trouver la longitude, et rien dans tout cela « n’appartenait à un navigateur considéré comme homme de mer », disaient Borda et Lévêque. Il restait à engager les marins à mettre en pratique ce que d’autres avaient inventé, et il y avait là un très grand obstacle à surmonter, car « dans toutes les innovations, ajoutaient-ils, il y a un problème moral à résoudre, plus difficile que celui qui parait occuper le premier rang et auquel les destinées de celui-ci sont souvent attachées ».
![]()
Comment les marins accueillaient-ils les résultats auxquels parvenaient les savants et les horlogers et quels efforts faisaient-ils ou étaient-ils contraints de faire pour les utiliser ? On fit d’abord quelques tentatives pour développer l’instruction des pilotes. Bouguer avait publié son Traité de Navigation à la demande de Rouillé qui le lui avait demandé parce que « la théorie devait continuellement éclairer la pratique et diriger avec lumière la main qui travaille », et on pensait qu’elle permettrait aux pilotes de parvenir beaucoup plus tôt « à cette habitude qui leur était nécessaire ». Bouguer lui-même exhortait les hydrographes à s’efforcer de remplacer les premiers inventeurs : « mathématiciens habiles qui sur l’exposition des besoins du marin ont découvert, étant à terre, l’art de naviguer », pour instruire les pilotes. Même La Caille donne une nouvelle édition de l’ouvrage de Bouguer, non pas seulement pour rendre le volume moins volumineux, plus portatif et moins cher, mais, aussi parce qu’il avait remarqué « qu’on ne mettait pas les navigateurs assez au fait des calculs familiers aux astronomes, quoique la plupart en sentissent la nécessité et l’utilité ». Il trouvait qu’on avait des préjugés sur leur difficulté et que Bouguer n’y avait pas assez porté attention. Enfin Turgot, qui passa un mois au ministère de la Marine en 1774, eut, d’après Rochon, l’idée de fonder un corps de pilotes astronomes dotés d’excellents instruments. Il ne voulait pas que « l’astronomie nautique, seul guide assuré du navigateur, fut, au mépris de la vie des hommes et de la sureté de la navigation, plus négligée en France que chez les autres puissances maritimes de l’Europe ». « On obtint quelques résultats, puisque sur la Flore, les pilotes s’instruisirent et furent l’objet de « témoignages si favorables rendus en leur faveur que le ministre leur fit distribuer au retour un sextant fabriqué en Angleterre, prix que le roi daignait leur accorder ». Mais les procédés astronomiques exigeaient des connaissances générales et spéciales qui devaient toujours rester au-dessus de leur culture et qu’ils ne purent jamais acquérir. En particulier la méthode graphique que La Caille, qui pourtant « avait été à même de connaître les habitudes des navigateurs », avait imaginée pour eux, leur offrit toujours des difficultés insurmontables.
![]()
Ces tentatives pour cultiver les pilotes remontaient d’ailleurs fort loin. En 1508, par exemple, Americ Vespuce, nommé « piloto mayor » était chargé en Espagne d’examiner les pilotes sur l’emploi de l’astrolabe et du quart de cercle, d’approfondir s’ils réunissent la théorie à la pratique, de veiller à ce qu’ils indiquent la position exacte des terres nouvellement découvertes.
![]()
Il fallait s’adresser aux officiers. Fleurieu le fit avec sévérité. « On ne saurait trop inviter les officiers à se familiariser avec les observations astronomiques », disait-il en 1773 ; puis il critiquait les pilotes et reprochait aux officiers leur obstination à ne pas se mettre à l’ouvrage. « La manœuvre fut de tout temps la science chérie de l’officier, écrivait-il, et on doit convenir qu’elle est la partie la plus brillante et la plus séduisante de son métier. » Le pilotage, grossier et incertain, méritait au contraire d’être dédaigné, ce qui justifiait l’abandon de l’estime aux pilotes.
![]()
Mais l’estime, c’était le hasard ; « quelles mers en effet n’avaient pas été couvertes de débris de vaisseaux que les erreurs de l’estime, l’indécision ou l’ignorance avaient perdus ». Il fallait donc décider les officiers à entrer « dans la carrière que les arts et les sciences avaient ouverte, les déterminer enfin à s’emparer exclusivement de la conduite de la route ». Et il plaidait en faveur de la navigation astronomique, engageant les jeunes officiers à travailler pour ne dépendre en aucun cas des préjugés des pilotes et se mettre en état au moins de dévoiler leurs petites ruses et les subterfuges grossiers auxquels ils recouraient pour corriger l’estime à la vue des terres ; enfin il espérait qu’ « une pratique aveugle cédant à des méthodes susceptibles de précision », on verrait bientôt les navigateurs empressés à jouir des découvertes qui assuraient « la sécurité des expéditions, la fortune des citoyens et surtout la conversation des hommes ».
![]()
Mais, à lire des auteurs plus récents, on peut être aussi amené à penser que l’appel de Fleurieu ne porta pas beaucoup de fruits. En 1799, année de sa mort, Borda, par exemple, écrit qu’ « il est temps que les marins cessent de regarder les sciences mathématiques et physiques comme inutiles à la pratique de la navigation et à ses progrès », car « pour l’art sublime de conduire le vaisseau et d’assigner à chaque instant sa position, tous les efforts de la pratique et sa continuité n’ont jamais rien produit et ne pouvaient rien produire », de sorte « que tout doit porter les marins à cultiver les sciences et à les honorer » . Enfin Rochon pense de même lorsqu’il dit, en 1807, que « la plupart des navigateurs regardent encore la connaissance de la longitude comme une chimère », et que leur faculté intellectuelle ne leur permet pas de faire usage des bons instruments crées pour eux. Seulement c’était peut-être chez lui le souvenir de vieilles rancunes nourries trente-six ans auparavant contre Kerguelen, qu’il avait quitté à l’Ile de France, en août 1771, parce que cet officier « ne sentait pas le prix de l’instruction et s’efforçait à éloigner ceux qui servaient sous ses ordres de toute application aux connaissances qu’il leur importait le plus d’acquérir ».
![]()
Ces tableaux sont poussés au noir. Si on a toujours rencontré des officiers du parti de Kerguelen, c’est-à-dire peu porté à la culture, par contre, à toutes les époques aussi, on peut en trouver un grand nombre ayant acquis ce qu’ils devaient connaître pour bien jouer leur rôle de marin. Fleurieu, déjà, atténuait la portée de ces critiques, en ajoutant en note que ses réflexions ne pouvaient être applicables à l’avenir, car depuis longtemps le goût et la pratique des sciences exactes s’étaient répandus dans la marine, de sorte que l’usage des méthodes nouvelles ne pouvait manquer de devenir bientôt général.
![]()
Rappelons d’abord Radouay qui, au commencement du XVIIIe siècle déjà, prophétisait et parlait des résultats obtenus avec ses montres afin que les officiers vissent les avantages qu’ils pouvaient en retirer. Nous connaissons aussi Bory, et Chabert qui, en 1753, nous apprend que « plusieurs officiers » commencent, en vue de la géographie, à s’attacher aux pratiques d’astronomie nécessaires à l’utilisation des observations lunaires.
![]()
Or, l’année précédente, l’Académie de Marine avait été instituée officiellement. Son origine fut toute spontanée comme celles de l’Académie des Sciences et de l’Académie française. Avant 1752, des officiers, dont le principal était Bigot de Morogues, capitaine de vaisseau et capitaine d’artillerie, se réunissaient chaque semaine à Brest pour conférer sur les sujets maritimes. Bigot profita d’un passage de Rouillé à Brest pour lui demander de donner un caractère officiel à ses assemblées, et sur le rapport de membres de l’Académie des Sciences, chargés d’assister aux séances, Rouillé donna à la Société, le 30 juillet 1752, son premier règlement. Elle comprenait 72 membres, 10 honoraires, dont Bouguer ; 10 académiciens libres, dont d’Après, Bellin, Pézenas ; 30 académiciens ordinaires, tous attachés au service de la marine, dont Bory et Chabert, et 22 membres adjoints, tous marins également, dont Goimpy. Aucune branche de la science nautique ne devait lui rester étrangère. Elle se proposait, en particulier, « d’éclairer la pratique de la navigation en la soumettant à l’épreuve d’une théorie rigoureuse », et en unissant d’ailleurs intimement les deux disciplines, car elle pensait que « si l’expérience sans la théorie est longue, incertaine, et n’est le plus souvent qu’un tâtonnement aveugle qui retarde le progrès, la théorie sans l’expérience n’opère par contre sans danger que dans le cabinet ». On y travailla sérieusement, malgré les nécessités du service qui apportèrent souvent des irrégularités dans l’observation du règlement. Il devait y avoir une séance par semaine. Pourtant, de 1756 à 1765, pendant la guerre coloniale, et après le Traité de Paris, il y en eut très peu ; même on n’en compte aucune en 1757 et 1759 par exemple et de 1762 à 1765. Mais, par une ordonnance de 1765, Choiseul réorganisa la marine, et quatre mois après le jour où elle fut décrétée, les séances recommencèrent. Enfin, encore à la demande de Morogues, elle fut reconstituée sur des bases nouvelles par Praslin. Le nouveau règlement, qui est du 24 avril 1769, la plaçait sous la protection directe du roi, la faisant Académie royale de Marine. Il lui destinait tous les ans 4.000 livres, au lieu de 3.000 qui lui étaient délivrées auparavant, pour achat de livres et d’instruments, et cette somme fut portée, vers 1780, à 6.000 livres. On y trouve alors Pingré, Bezout, Lalande, Lemonnier, Borda, Rochon, Fleurieu, Grenier, etc. Elle lutta contre les officiers ignorants et jaloux qui s’écriaient que la théorie n’était bonne à rien et que la pratique seule pouvait faire un bon officier. Rappelons enfin qu’en 1771 elle fut affiliée à l’Académie des Sciences.
![]()
Elle s’occupa toujours beaucoup des questions de navigation. Nous avons dit les progrès qu’elle fit faire à la construction des boussoles et comment elle fit traduire le Nautical. Elle prit à cœur également la question de l’établissement, à Brest, d’un observatoire de la marine, destiné à recevoir des instruments tels que des sextants et des cercles propres à être délivrés aux officiers qui en faisaient la demande au moment de leur départ en campagne. En 1777, Borda fut chargé d’en parler au ministre. En 1781, l’Académie décida d’employer à la construction de cet observatoire 7.000 livres qu’elle avait en caisse, et elle demanda des secours au Gouvernement. En 1783, elle acheta même le terrain sur lequel sont aujourd’hui bâtis le temple protestant, le palais de justice et les maisons attenantes dans le but d’y élever l’édifice en question, et si elle ne réussit pas dans cette entreprise, puisque le kiosque en bois qui fut bâti sur ce terrain pour servir d’observatoire ne fut érigé qu’en 1797, alors qu’elle n’existait plus, il ne faut pas moins lui compter les efforts qu’elle fit dans ce sens [1]. Elle avait été emportée en effet par le décret du 14 août 1793, qui avait supprimé toutes les Académies, et n’avait pas été reconstituée au moment de la formation des classes de l’Institut. On lui devait pourtant un nombre considérable de mémoires qui prouvent qu’elle s’était acquittée activement de sa mission. Sous son impulsion, toutes les sciences nautiques avaient progressé.
![]()
D’autre part, pendant une grande partie de son existence, on se préoccupa de donner aux officiers la culture qui leur devenait indispensable. Sur l’ordre de Choiseul, l’académicien Bezout avait écrit un Cours de Mathématiques destiné à donner aux Gardes du pavillon et de la Marine les connaissances qu’on exigea dès lors d’eux pour en faire des officiers. Ce cours très étendu comprenait de l’arithmétique, de l’algèbre, de la géométrie, de la géométrie analytique, de la mécanique, de la trigonométrie plane et sphérique, les éléments du calcul différentiel et intégral, enfin un traité de navigation. Au total pour les mathématiques, à peu près le programme d’entrée au « Borda » et le programme de l’ « école Navale » il y a une quarantaine d’années, sauf en mécanique. Cette collection scientifique devait permettre aux marins, dit Fleurieu, de se passer des astronomes à la mer ou pour faire les cartes. Berthoud, en 1773, nous apprend que l’examen qu’on faisait subir aux Gardes de la marine obligeait « ces jeunes officiers de s’instruire, en sorte qu’ils devaient être en état de suppléer au besoin à l’usage des horloges par les observations et les méthodes astronomiques », et Rochon, qui comparait la théorie au levier d’Archirnède, reconnut que depuis Bezout, une foule d’officiers ayant acquis des talents supérieurs, l’étude avait crée en peu de temps de grands hommes de mer.
![]()
Pendant le voyage de Verdun et de Borda, plusieurs officiers observèrent et calculèrent des longitudes, soit au moyen des montres, soit par la Lune, et on utilisa les nouvelles méthodes en service courant, à peu près dès qu’elles furent crées. Ainsi, en 1772, aussitôt parue la première traduction du Nautical, de Langle, la Prévalaye et Trémargat font des distances à la mer sur la Dédaigneuse, et ils rendent compte de leurs résultats à l’Académie de Marine. Ils observent de préférence de jour, des distances luni-solaires par conséquent. Généralement deux d’entre eux mesurent les hauteurs des points de contact des disques pendant que le troisième prend la distance. Pour apprécier exactement la précision de la méthode, ils observent non seulement au large, mais surtout en vue de terre et même en rade, à Cascaes par exemple. Le plus souvent, l’erreur sur la longitude est comprise entre 30 et 60’. Elle est très rarement plus grande que 1°, et elle tombe parfois à quelques minutes (15 à Cascaes). Leur campagne avait eu lieu en juin et juillet sur les côtes d’Espagne et de Portugal, du cap Finisterre au cap Saint-Vincent.
![]()
On suivit leur exemple pendant la guerre de l’Indépendance Américaine. De 1781 à 1784, dans la flotte de Suffren, il n’y avait pas de chronomètre, mais les officiers y observèrent des distances lunaires. On en trouve à une vingtaine de dates. Elles sont faites surtout dans le voyage de retour et placées en général au milieu des grandes traversées ou avant les atterrissages. Ils en prirent un grand nombre avant de reconnaître la terre dans la route de Port-Louis au Cap, alors que l’estime les mettait dans le Natal, ce qui était tout à fait déroutant, puisque le très fort courant du canal de Mozambique devait les entraîner en avant, non en arrière. Dans ces parages, leurs longitudes observées leur donnèrent heureusement des positions correctes. De même, en allant du Cap à Gibraltar, ils observèrent une longitude pour atterrir sur les hauts-fonds de Rio Grande, sur lesquels, coïncidence curieuse, Vasco de Gama avait également passé, en revenant pour la première fois de la côte de Malabar.
![]()
D’Estaing et de Grasse opéraient dans l’Atlantique nord. D’Estaing était parti de Toulon en avril 1778 avec 12 vaisseaux et 5 frégates. Il avait Borda pour chef d’état-major. Suffren commandait le Fantasque, Bougainville le Guerrier, Chabert le Vaillant. Borda, d’après F. Berthoud, avait sa montre n°10, construite comme le n° 8, mais à échappement libre. Chabert emportait l’horloge 17 à poids et une montre n° 3 à ressort, qui était sans doute celle que nous connaissons, car sa montre astronomique de poche, qui porte le même numéro, ne fut exécutée qu’en 1806. La traversée de Toulon à la Delaware dura 99 jours. Chabert calculait les longitudes par ses montres et Borda prenait des distances lunaires. Leurs résultats, vers le milieu de la traversée, s’accordaient à 15’ près. En 1781 et 1782, Chabert a le commandement du Saint-Esprit dans la flotte de de Grasse. Il emporte l’horloge 22 à poids et la montre n° 2 à ressort, toutes deux de F. Berthoud encore. Elles lui permettent d’atterrir à la Martinique en venant de Brest, à 20’ près, après six semaines de mer. Et il faisait l’éloge des « nouvelles » méthodes qui rendaient la navigation plus sure et plus rapide de tout le temps que faisaient perdre les tâtonnements des pilotes. Il était heureux d’offrir à « ses généraux des moyens d’assurance pour la direction des routes de l’armée » ; il espérait que la « précision de ses atterrissages exciterait le zèle d’un grand nombre d’officiers très instruits, empressés à l’imiter » ; enfin il pensait que l’utilité reconnue des horloges engagerait le gouvernement à multiplier ce moyen de sureté pour la navigation des vaisseaux du roi et qu’on parviendrait bientôt à y faire participer les bâtiments du commerce ».
![]()
Les deux campagnes de Chabert condamnèrent les horloges à poids. Le 17 et le 22 ne purent plus servir en effet après les combats de la Grenade et de la Chesapeake. On ne pouvait les déplacer sans d’extrêmes précautions, car alors on risquait pour le moins de les arrêter, et l’horloge n° 8 avait été abimée dans un transport par terre où les rouliers la renversèrent. On les laissait donc en place, à proximité des canons. Or, au combat de la Chesapeake, la pièce qui était devant l’armoire aux montres rompit ses bragues et recula jusque dans l’armoire qu’elle défonça. Donc, concluait Chabert, on ne doit en construire qu’à ressort, plus petites et plus maniables. Le n° 3 n’avait eu qu’un saut au combat de la Grenade et le n° 2 lui donna toujours sa longitude à 15’ ou 20’ près dans ses plus longues traversées, sauf de Saint-Domingue à Groix, à sa seconde rentrée en France, où il fut en erreur de 2°5. Mais il attribua cette grosse irrégularité sans précédent à un accident qu’on lui avait caché. Le chevalier de Ternay, qui transporta Rochambeau à Rhode-Island, en 1780, avait aussi une montre de F. Berthoud. C’était la petite horloge à longitude n° 1 qui avait été exécutée en 1777.
![]()
Elle approchait des montres de poche et pouvait aussi bien être transportée en voiture. Elle était encore à balancier horizontal suspendu et guidé par des rouleaux et à châssis de compensation, mais à vibrations libres. En 1799, Bruix emmena 25 vaisseaux, 11 frégates et 1.600 hommes de troupes de Brest à Toulon, d’ou il ravitailla Gênes et Savone en évitant la flotte de Keith, puis il se réunit à Carthagène à une flotte espagnole et ramena le tout à Brest. Or il avait également une horloge de Berthoud, le n° 8, et on peut croire que la précision qui en résulta pour sa navigation, en lui permettant d’agir rapidement, contribua au succès de sa campagne. Enfin Humboldt, en 1803, emporta une montre de F. Berthoud en Amérique.
![]()
Cependant, il n’y avait pas assez de montres. En 1781, Gaigneur écrivait dans son Pilote instruit : « On a lieu d’espérer que les montres résoudront le problème de la longitude, mais elles ne sont pas encore assez répandues et, vraisemblablement, il s’écoulera bien du temps avant que leur usage soit général, et nous ne nous en occuperons pas. » De même, dans l’édition de 1781 du traité de Bouguer, on lit que « les horloges étaient encore trop imparfaites » et on ne s’en occupait pas davantage. Effectivement, en 1790, Marchand, partant de Marseille pour faire la tour du monde, ne peut se procurer d’horloge à longitude et, en 1793, même, Lalande n’en dit pas grand’chose dans son Abrégé de Navigation. Même en 1808 encore du Bourguet, dans un savant Traité de Navigation, donne peu de renseignements sur les montres. Il indique entre autres la détermination de la marche par l’observation d’une étoile à une lunette solidement fixée et il est pressé de conclure en écrivant : « mais abandonnons les montres, sujettes à se déranger en ne les considérant tout au plus que comme un moyen secondaire d’avoir la longitude. » C’était peu encourageant pour les artistes.
![]()
Leur nombre s’accrut bientôt. Nous avons déjà vu que F. Berthoud, à partir de 1789, ne céda plus aucune de ses constructions. Mais depuis 1786, son neveu Louis Berthoud donnait d’excellents instruments. Malheureusement, il n’a pas, comme son oncle, laissé beaucoup d’écrits. Un décret impérial du 10 mars 1806 lui confia quatre élèves qu’il devait initier à la construction des montres destinées à la marine et il publia, en 1812, un opuscule contenant, sous une forme trop exclusivement littéraire pour donner beaucoup de détails précis, le résume de ses leçons. Le nombre de ses ouvrages s’élevait alors à 150. Il avait fait venir un artiste sachant travailler les pierres précieuses, « qui avaient été mises en usage par les Anglais bien avant nous », mais qui commençaient à se multiplier en France. Il avait trouvé un joli mot sur le spiral : « C’est l’âme de la montre, disait-il, et le spiral isochrone en est l’âme intelligente. » Il préférait au spiral plat de l’ancienne forme, le spiral cylindrique, qu’il trouvait beaucoup plus avantageux, même dans les montres à gousset. En 1793, il en employa aussi en forme de fusée, c’est-à-dire de tronc de cône ; il pensait que ce système avait un degré de précision supérieur au spiral cylindrique. Ses spiraux étaient d’ailleurs pitonnés suivant la règle d’isochronisme de Le Roy. Il compensait seulement par le balancier, afin de ne pas détruire l’isochronisme, et, employant à cet effet le « moyen annoncé par Pierre Le Roy », il faisait le balancier de deux ou quatre arcs bimétalliques avec masses de laiton. Son échappement enfin était à détente pivotée. En 1793, l’Académie des Sciences avait proposé pour sujet de prix la construction d’une montre de poche pour déterminer la longitude à la mer, en spécifiant que la division du jour devait être en 10 heures, celle de l’heure en 100 minutes, et celle de la minute en 100 secondes. Rien n’avait été envoyé au moment de la suppression des académies. Mais l’Institut, en l’an IV, reproposa le même sujet, toutefois sans exiger la décimalisation. Le lauréat devait recevoir une médaille d’or de la valeur de un kilogramme. Louis Berthoud reçut la récompense. II avait envoyé deux montres nos l et 2, désignées par les devises « ma liberté fait ma constance » et « au temps qui instruit ».
![]()
Louis Berthoud mourut en 1813 et, peu après, Bréguet fut nommé horloger en titre de la marine. Ce dernier fut alors, à partir de 1820 et pendant plusieurs années, presque exclusivement le seul fournisseur de la marine. C’est lui qui donna à l’échappement libre à ressort à très peu près sa forme actuelle. Excellent artiste, il se plaisait aux difficultés et on a conservé de lui, au Conservatoire des Arts et Métiers, un chronomètre à spiral cylindrique de verre. En 1822 cependant on commença à acheter des montres à Motel, ancien élève de L. Berthoud, qui reçut le même titre que Bréguet, de sorte qu’en 1832 on avait 44 chronomètres de Berthoud, 29 de Bréguet et 70 de Motel, ce qui portait l’approvisionnement de la marine à 143. C’est alors que d’autres artistes demandèrent à participer à la fourniture et que le ministre de Rigny, acquiesçant à leur demande, décida d’acheter les montres à l’avenir au concours. Dès l’année suivante, en 1833, les épreuves commencèrent pour l’achat de 16 montres dont on prit 12 à Motel, 3 à Bréguet et 1 à Jacob.
![]()
Vers 1815 on était donc à peine en mesure de délivrer des montres à un certain nombre de bâtiments. Ce fut cependant le 1er septembre de cette année que le ministre comte de Jaucourt signa une « Instruction pour les bâtiments à bord desquels sont embarquées des montres » qui doit être le premier règlement officiel de l’espèce, de sorte qu’on peut faire remonter à cette époque l’intention ministérielle de fournir des montres à tous les navires. On y disait que les services rendus par les montres en faisaient embarquer dans presque tous les voyages au long-cours et on y recommandait l’emploi d’une montre de poche pour tenir lieu de compteur (le compteur véritable ne devant arriver que vers 1843 où on en commanda 150 à Berthoud, Bréguet, Jacob et Gannery), et l’observation des distances lunaires pour contrôler de temps en temps la valeur des chronomètres. Les premiers journaux des montres datent de cette instruction.
![]()
Cependant dans une lettre du Ministre au Préfet maritime de Brest, du 27 mars 1815, on relève qu’ « il ne sera délivré de montre que sur les ordres du ministre » et sur demande et « si la destination du bâtiment en comporte l’emploi ». Les montres coûtent cher, ajoute-t-on ; elles sont dangereuses en les mains d’officiers peu instruits. » Rosily est alors directeur du Dépôt de la Marine. En 1816 le 16 avril, une autre lettre du ministre confie au Comte Gourdon, à Brest, qu’il n’y a plus que quatre montres à Paris et la Chaumareys, commandant de la trop célèbre Méduse, s’en voit refuser une pour sa mission, la Méduse ayant ordre de revenir à Brest sitôt ses passagers débarqués. Par contre en même temps l’Écho reçoit à Rochefort le n° 131, pour sa campagne au Sénégal ; mais la montre ne rend aucun service ; parce qu’elle s’arrête dès le second jour du départ de Rochefort.
![]()
C’est encore vers ce moment qu’on trouve pour la première fois dans les traités de navigation des chapitres détaillés sur l’emploi des montres comme sur des instruments devenus classiques. (Nous savons que les méthodes par la Lune étaient exposées depuis longtemps au contraire.) Tels sont les traités de Rossel, rééditant eu 1814 le cours de Bezout, et celui de Guépratte, directeur, après Rochon et Maingon, de l’observatoire de la marine à Brest. Guépratte, en 1816, prit comme exemple de marches des extraits de journaux de 4 montres qu’il avait étudiées à l’observatoire : deux d’entre elles avaient été très irrégulières et elles avaient dû être renvoyées au constructeur pour réparation ; les deux autres, qui s’étaient montrées bonnes furent délivrées le 31 août et le 10 septembre 1814 à deux bâtiments : le Lis et la Thémis. En feuilletant au hasard des journaux de bord entre 1820 et 1830, on trouve fréquemment du reste des preuves de l’usage des montres et de l’emploi des distances lunaires. Citons, en 1821, le brick le Curieux allant de Lisbonne aux Açores avec la montre n° 80 ; la Thétis en 1822 qui, en Méditerranée, a une montre et observe des distances ; la Vénus qui en 1828 a deux montres et, au commerce, le Bordelais qui a le chronomètre Bréguet n° 172 pendant une circumnavigation de 1816 à 1819. Toutefois, jusqu’en 1827, les journaux ne portent encore dans l’encadrement imprimé réservé au point à midi, que la rubrique : longitude d’arrivée, tandis qu’il y a deux indication relatives à la latitude, l’une pour la latitude d’arrivée ou estimée, et l’autre pour la latitude observée Mais à partir de 1827, le journal de bord prend à peu près la forme qu’il a gardé depuis.
![]()
Enfin Guépratte, dans un traité postérieur à 1835, donne des extraits des marches de 11 montres. Il est vrai qu’il croit nécessaire de faire remarquer qu’on devra refuser « à ces instruments une confiance aveugle » et « qu’on sera toujours dans l’obligation de comparer leurs résultats à ceux que fourniraient les distances lunaires ». Deux d’entre elles en effet ont manifesté en 7 mois une variation de marche de 19 secondes. En rade, le signal horaire destiné à leur vérification était fait à ce moment par un brûle-amorces, comme du temps de l’Isis et de la Flore.
![]()
A cet effet, en 1818, l’observatoire à Toulon fut rattaché par des opérations géodésiques à l’église Sainte-Marie, et, par des signaux de feux, à celui de Marseille ; et la construction de celui de Lorient fut ordonnée en 1822 par le ministre de Clermont-Tonnerre qui avait remarqué, dans une visite qu’il fit à ce port, que les bâtiments sur rade n’avaient aucune ressource pour régler leurs chronomètres.


 Suivi RSS
Suivi RSS Conception
Conception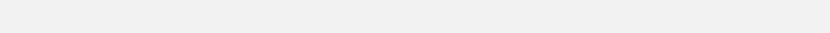


 Version imprimable
Version imprimable Publié Décembre 2014, (màj Décembre 2014) par :
Publié Décembre 2014, (màj Décembre 2014) par :








